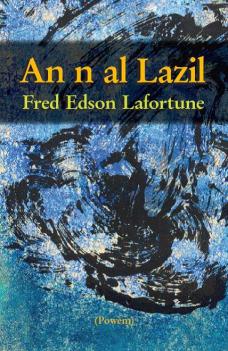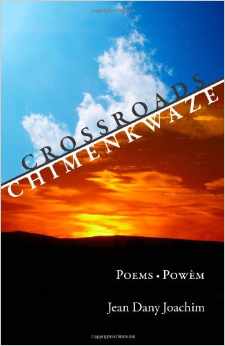Category Archives: French interviews
Carlos Liscano : «Tout écrivain est une invention»

Par Yann Nicol
Devenu écrivain après avoir été détenu pendant treize ans dans les prisons de la dictature uruguayenne, Carlos Liscano compose depuis une œuvre éclectique – récits, romans, fables, essais, théâtre, journaux – hantée par son expérience personnelle, son rapport à l’écriture et sa quête de liberté. Rencontre avec un des grands auteurs latino-américains contemporains, en compagnie de son fidèle traducteur Jean-Marie Saint-Lu, à l’occasion de leur présence au festival Colibris, à Marseille.
Dans le prologue de Souvenirs de la guerre récente, vous dites qu’au début des années 1980, c’est dans le pénitencier de Libertad, où vous avez été détenu par la dictature uruguayenne pendant treize ans, que vous avez découvert que vous étiez un écrivain…
Carlos Liscano. Dans une prison où il y a autant d’isolement que dans celle de Libertad, on devient facilement quelqu’un de délirant… L’isolement, le silence, l’absence de relations humaines provoquent un délire, salutaire, qui permet de se protéger de la réalité. On peut dès lors se prendre très facilement pour un saint ou pour un prophète. Moi, je me suis pris pour un écrivain alors que je n’avais encore rien publié… En 1981, quand j’ai commencé à écrire, cela faisait huit ans que j’étais en prison. J’étais très isolé, je n’avais pas de lumière, pas d’eau, rien pour écrire, je ne parlais jamais à personne, j’ai décidé d’écrire un roman mental, qui était un délire, mais aussi une façon de me protéger contre l’ambiance hostile du pénitencier. Quelques mois plus tard, quand j’ai réussi à avoir du papier et un stylo, j’ai véritablement écrit un roman… Après cela, je me suis pris pour un écrivain ! Même si je ne le disais à personne, ça m’a aidé à vivre pour les cinq années de captivité qui ont suivi. Quand je suis sorti de prison, je voulais être un écrivain, je ne voulais rien faire d’autre. Quand on m’a demandé de quoi j’avais besoin (j’avais en réalité besoin de tout : des habits, du travail, de l’affection surtout, même si je ne m’en rendais pas compte), j’ai dit que j’avais besoin d’une machine à écrire. On m’en a trouvé une, et deux jours plus tard j’ai commencé à taper…
Dans ce livre, vous évoquez aussi votre découverte de la nouvelle de Dino Buzzati, Les Sept Messagers. L’éditeur a reproduit des fac-similés de l’époque où vous aviez réécrit l’ensemble de la nouvelle, et construit une sorte d’analyse mathématique du texte de Buzzati…
Carlos Liscano. En prison, il n’y avait pas beaucoup de livres, et surtout pas de bons, finalement j’ai lu un grand nombre de mauvais livres dans ma vie… J’ai, en réalité, été poussé à écrire par la lecture de tous ces mauvais livres : je me disais que je pouvais moi aussi en écrire un mauvais, mais pas aussi mauvais que celui que j’avais dans les mains ! C’est là que j’ai découvert l’excellente nouvelle de Dino Buzzati, intitulée Les Sept Messagers, que j’ai relue des dizaines de fois dans ma vie. En prison, je l’ai aussi recopiée, car je savais que j’allais en être privé. Cette nouvelle me fascine encore car elle a une structure mathématique très solide qui ne relève pas du hasard. Ayant moi-même étudié les mathématiques, je cherchais à dégager la structure de cette nouvelle, notamment dans son traitement du temps. C’était la première fois que cela était fait dans le monde… J’ai effectivement fait ce calcul à la main, et je crois qu’il n’y a pas d’erreur !
Vous avez lu beaucoup de mauvais livres, mais vous en avez aussi lu beaucoup de bons. Tous vos romans constituent des hommages, des variations, des références claires aux œuvres qui vous ont marqué. Pourquoi assumer cette filiation avec tant de précision ?
Carlos Liscano. Dans Le Lecteur inconstant, je suis arrivé à la conclusion que je n’étais pas un écrivain, mais un «réécrivain». Ce qui a sans doute à voir avec mon expérience de la prison. Je n’avais pas d’histoire à raconter pendant ma captivité, donc j’ai réécrit les livres que j’avais lus. Je voulais par exemple écrire un livre dans la lignée de Molloy, que j’avais lu deux fois, et que j’ai tenté de réécrire de mémoire. Souvenirs de la guerre récenteest une variation autour du Désert des Tartares de Dino Buzzati, alors que La Route d’Ithaque constitue une transposition duVoyage au bout de la nuit, de Louis Ferdinand Céline. Mon dernier livre, Vie du corbeau blanc est la réécriture de dizaines de livres que j’ai lus, une sorte d’hommage à la lecture depuis l’enfance. Mon traducteur, Jean-Marie Saint-Lu, dit qu’il faudrait faire un concours pour repérer toutes les citations et références de ce roman…
Parmi les motifs récurrents de vos livres, il y a une interrogation constante sur la solitude, la liberté et la claustration. Le personnage de Souvenirs de la guerre récente semble paradoxalement trouver une forme de liberté individuelle dans un système militaire et répressif, comme si la privation de liberté pouvait aussi mener à l’émancipation…
Carlos Liscano. Comme je le disais, ce roman rend hommage au Désert des tartares. Il traite de la perte de la liberté quand elle se fait de manière graduelle. Ce n’est pas seulement en prison que l’on perd sa liberté. On perd sa liberté dans une organisation trop structurée : dans un parti, dans une église, dans une entreprise… On accepte les règles et, après quelques années, on n’arrive plus à vivre en dehors de ces règles. Le problème, c’est que nous voulons à la fois la liberté et la sécurité. Or plus nous faisons attention à la sécurité, moins nous avons de liberté… Dans Souvenirs de la guerre récente, je mets en scène le cas extrême d’un jeune homme qui trouve dans l’armée un moyen d’être libre. Quand il retrouve la liberté à l’extérieur, il a peur, car dans l’armée, il n’avait pas à prendre de décisions. La vie libre suppose qu’on prenne sans cesse des décisions : lui préfère la sécurité à la liberté. On voit parfois des gens qui ont été emprisonnés de nombreuses années et qui, à leur sortie, veulent retourner en prison et fuir la liberté car ils sont habitués à cette vie très règlementée…
Jean-Marie Saint-Lu, dans la postface du livre, vous évoquez la dimension allégorique de Souvenirs de la guerre récente, qui constitue une sorte de fable…
Jean-Marie Saint-Lu. Ce roman est un bon exemple de ce que Carlos nommait la réécriture, car si on pense d’un bout à l’autre du livre au Désert des Tartares, on voit bien en réalité que tout est complètement détourné. Souvenirs de la guerre récente est une allégorie dans laquelle la perte de l’idée même de liberté est le résultat d’un processus. Le personnage central fait le choix de revenir à la caserne, mais parce qu’auparavant, il a été complètement décérébré. L’ennemi, dans cette guerre, est à l’intérieur. Cette fable fait sans doute écho à toutes les années d’emprisonnement de Carlos Liscano, à cette oppression qui anéantit toute volonté, en particulier celle de la liberté. Ce qui est saisissant, c’est qu’au moment où le personnage est enfin libre, il ne veut pas de cette liberté. J’y vois une très forte image de l’oppression récente des dictatures d’Amérique Latine…
L’autre particularité de l’œuvre de Carlos Liscano réside dans la grande simplicité de l’écriture, une prose minimaliste et poétique qui accentue cette dimension de fable, de conte philosophique… Quelles difficultés cela présente-t-il pour le traducteur que vous êtes ?
Jean-Marie Saint Lu. L’œuvre de Carlos Liscano présente en effet une grande simplicité dans l’écriture. Je pense à l’œuvre d’un poète comme Gérard de Nerval, qui écrit très souvent des phrases simples : sujet, verbe, complément… Et c’est très beau, car il y a une musique ! Le problème pour la traduction, c’est que l’espagnol est une langue très accentuée, alors que le français est beaucoup plus plat. Pour traduire, il faut que j’entende ma traduction, et il faut que j’y retrouve la musique que j’ai entendue en espagnol. Or cette musique est irrécupérable de manière littérale. C’est pour ça que j’utilise différentes méthodes : la ponctuation, l’ordre des mots… Si vous traduisez Carlos mot à mot, c’est d’une platitude absolue, alors que sa langue est extrêmement musicale en espagnol !
Carlos Liscano. Sachez que le fait d’écrire de courtes phrases n’est pas un signe de génie, mais plutôt de mon incapacité à utiliser les phrases longues ! Quand j’ai commencé à écrire, je les divisais en trois, et cela donnait trois phrases courtes que j’arrivais à maîtriser. J’écris toujours de cette manière…
Dans L’écrivain et l’autre, vous écrivez : « Tout écrivain est une invention. Il y a un individu qui est un, et un jour il invente un écrivain dont il devient le serviteur ; dès lors il vit comme s’il était deux. » Dites-nous un mot de cette invention, et de cette cohabitation au fil du temps…
Carlos Liscano. C’est une fausse théorie que je me suis inventée, quelque chose que j’ai ressentie. Au bout de huit ans en prison, j’ai commencé à écrire et ma vie a changé pour toujours. Il faut comprendre que quelqu’un comme moi n’avait pas de légitimité à se prendre pour un écrivain. C’était pourtant ce que j’ai fait. Je pense qu’en prison j’ai inventé un autre individu, qui a eu un comportement différent, et cet individu est resté en relation avec l’autre, avec le passé… Je suis aujourd’hui directeur de la bibliothèque nationale d’Uruguay, j’ai été auparavant vice-ministre de la culture, et si je ne m’étais pas inventé écrivain, je ne serais jamais arrivé à ces postes-là… Ma vie est le résultat de cette invention préalable ! La seule personne qui connaît le Carlos Liscano qui existait avant l’écrivain, c’est ma sœur. Et elle fait la différence entre l’écrivain et le frère. Le frère est lié à l’enfance, à la mère, tandis que l’écrivain représente le présent. Elle me rappelle souvent que nous sommes nés de la même mère, que nous avons été enfants ensemble, et qu’il ne faut pas que je me prenne pour un écrivain. Je pense que cette pseudo-théorie arrive à tous les écrivains. Un jour, ils se sont inventés une autre personne, qui allait écrire leurs livres. L’échec de l’écrivain est dans l’échec de l’invention : si on se trompe dans l’invention, il n’y aura pas d’œuvre…
Mais l’écrivain est celui qui tient la place la plus importante dans votre vie, n’est-ce pas ?
Carlos Liscano. Même quand je n’écris pas, comme c’est le cas en ce moment, je demeure un écrivain, car je vois la vie, l’amour, le travail, les relations humaines, comme un écrivain, en vue de cette œuvre qui sera peut-être un jour écrite… Tout dans ma vie se fait en fonction de mon être d’écrivain, c’est ma façon d’être au monde !
Vous évoquez aussi à plusieurs reprises l’incapacité que vous avez à écrire de la fiction, et la manière dont vos obsessions – l’isolement, la liberté, l’écriture – reviennent en boucle dans votre travail…
Carlos Liscano. Je crois qu’il y a un piège dans lequel nous pouvons tomber, nous écrivains, c’est d’écrire sur la difficulté d’écrire quand, précisément, on ne parvient pas à écrire… Jean-Marie Saint-Lu dit que L’écrivain et l’autre est un livre obscur, angoissant : il correspond en effet à une période sombre de ma vie, marquée par le désamour et par l’alcool. Je savais que le meilleur moyen d’en sortir était d’écrire un roman, mais je n’y suis pas arrivé… En revanche Le lecteur inconstant est un livre beaucoup plus lumineux car, dans la deuxième partie, j’ai trouvé une façon d’écrire ce roman qui est devenu Vie d’un corbeau blanc, comme un pendant fictionnel au Lecteur inconstant. On y retrouve un chapitre ou je réécris Moby Dick, mais aussi le douzième chant de l’Odyssée, Les Sept Messagers, le Tarzan de Burroughs… j’ai plagié tout le monde !Le Lecteur inconstant est un livre lumineux car j’avais retrouvé le bonheur d’écrire…
Jean-Marie Saint-Lu. Il faut préciser que Carlos n’est pas un plagiaire, mais plutôt l’exemple parfait du lecteur écrivain. Julien Gracq dit que tout écrivain écrit sur le terreau des autres écrivains, qu’on ne peut pas être écrivain ex nihilo. Chez les autres écrivains, les influences ne se voient pas directement, alors que Carlos Liscano les déclare ouvertement… Ce ne sont pas des plagiats car il détourne, il transforme : il prend un thème et fait des variations, à la manière d’un musicien.
Carlos, vous avez beaucoup travaillé pour le théâtre. Qu’est-ce que cela vous a apporté d’un point de vue littéraire, notamment pour l’écriture de vos récits et de vos essais ?
Carlos Liscano. Je me suis intéressé au théâtre car l’écrivain a une vie très solitaire et je savais que le théâtre pouvait déboucher sur un travail collectif. J’ai commencé en étant l’assistant de direction d’un metteur en scène suédois, ce qui m’a beaucoup appris. Ensuite j’ai commencé à faire des mises en scène comme amateur, des textes que j’écrivais ou que j’adaptais… et j’ai découvert qu’un metteur en scène de théâtre est aussi solitaire qu’un écrivain ou qu’un gardien de but, car il faut concevoir seul le rapport entre tous les éléments (acteurs, régisseurs, décorateurs). J’ai laissé tomber la mise en scène ! Le problème, c’est que les dramaturges sont en train de disparaître, car c’est souvent le metteur en scène qui écrit son propre texte et le modifie au cours des répétitions. L’écriture du théâtre est une expérience sur le langage, car il n’y a pas de descriptions. Le théâtre est action. Cela m’a appris à simplifier le langage, à couper les descriptions d’action inutiles ; c’est une excellente expérience pour un auteur de récits ou de romans. De plus, il faut penser le théâtre comme un mouvement. Un lecteur peut revenir en arrière, lire plusieurs fois, alors que le spectateur n’a que le moment présent.
Diriez-vous que les différents genres que vous avez explorés – romans, fables, journaux, essais, théâtre – sont autant de tentatives pour comprendre votre trajectoire, pour vous élucider vous-même ?
Carlos Liscano. Ces différentes recherches sont bien sûr une manière de se définir soi-même. Cela peut aussi être vu comme une incapacité à écrire des dizaines de romans… Après plusieurs années à écrire, je suis revenu à la recherche d’une définition du sujet, et actuellement ce qui m’intéresse le plus c’est une réflexion sur l’écriture. Pourquoi une personne peut passer trente ou quarante ans à écrire dans le silence ? Pour gagner de l’argent, pour la gloire ? Cela peut être un motif, mais il y a des manières plus efficaces pour arriver à cela… Je suis fasciné par le fait de passer autant de temps à cette tâche solitaire qui n’a pas de justification. Dans chacun de mes essais, j’ai essayé de répondre à cette question – qui suis-je ? – car comme tout le monde, je suis ce que je fais. Mais pourquoi fais-je ce que je fais ? On peut aussi dire que je fais ce que je fais car je suis ce que je suis… C’est un cercle vicieux et je crois que je n’aurais pas de réponses, même au moment de ma mort !
Merci à Luisa Marques dos Santos pour la traduction et à Pascal Jourdana pour la réalisation de cet entretien lors du festival Colibris
À voir sur Youtube un entretien avec Carlos Liscano réalisé par Fluctuat.net et un entretien réalisé par l’Université d’Angers
Source: Le magazine littéraire
Dany Laferrière : “La réponse la plus subversive à la dictature : être heureux !”

Véritable pendant à “L’Énigme du retour”, qui lui valut le prix Médicis en 2009, “Chroniques de la dérive douce” retrace la première année d’exil de l’écrivain haïtien. L’occasion de narrer avec poésie et raffinement l’ambivalence du déracinement et sa conquête de la liberté.
En 1976, Dany Laferrière fuyait sa patrie, où sa vie était en danger. Dans Chronique de la dérive douce, mélange de vers libres et de prose tout en fragments, l’écrivain, qui avoue n’écrire que sur lui-même, dresse un portrait de sa première année au Québec. Véritable pendant à L’Énigme du retour, ce roman, dont la première version est parue à Montréal en 1994, perpétue le dialogue entre l’enfant du Sud et sa terre d’adoption. Mais le vrai sujet du livre reste l’ambivalence du déracinement. Malgré la douleur de perdre son pays, la misère et les petits métiers avilissants de ses débuts, son départ d’Haïti a été une chance de se réinventer. Un vade-mecum pour tous les exilés…
Jeune Afrique : Vous publiez dans une version enrichie un roman écrit pour la première fois en 1994. Dix-huit ans plus tard, la question de l’exil paraît toujours autant d’actualité…
DANY LAFERRIÈRE : Oui, car des avions continuent de débarquer des jeunes gens dans toutes les capitales d’Occident, souvent en provenance de pays pauvres, ignorant s’ils y seront acceptés. À l’aube de mes 60 ans, j’ai voulu ressortir ce livre pour me rappeler le jeune homme que j’étais. À dix-huit ans d’intervalle, les choses n’ont pas changé, mais ma façon de les appréhender a évolué. Cette nouvelle version est enrichie de faits que j’avais initialement perçus sous une tout autre perspective. Chronique de la dérive douce reste encore le livre de mes débuts, des premiers pas d’un exilé dans sa nouvelle vie. Je l’ai écrit pour aider les gens à comprendre cette expérience à la fois excitante et traumatisante de l’exil. Ceux qui n’ont jamais quitté leur pays ignorent combien il est difficile de vivre en dehors de ses racines, de s’en défaire.
L’Énigme du retour participait aussi de ce désir ?
Dans L’Énigme du retour, il est question de longues et bouleversantes retrouvailles avec les miens, mais aussi avec un pays que je peine à reconnaître après trente-trois ans d’absence. Le temps qui passe et le poids de l’expérience établissent une relation singulière entre les deux ouvrages. Un peu comme si on présentait un jeune homme, puis l’homme d’expérience qu’il est devenu. Il s’agit bien d’une seule et même personne. Placé à l’autre extrémité de la vie du narrateur par rapport à L’Énigme du retour, Chronique de la dérive douce donne à mesurer le chemin parcouru. Et l’exil reste douloureux.
Véritable vade-mecum pour l’exilé, votre livre campe un personnage qui ne se laisse pas impressionner.
Je dédie ce livre à tous ceux qui arrivent dans une nouvelle ville, sans exclusive. Quelle que soit la position qu’ils y occupent, la pire des choses, c’est de s’appesantir sur soi, de se plaindre. L’exilé n’est pas un touriste. Il n’est pas venu voir comment vivent les autres, mais pour participer à leur aventure, que cela lui plaise ou non. L’énergie qu’on possède en arrivant, il ne faut pas la gaspiller en larmes. Mon souhait est que ce livre soit lu par de jeunes Africains avant même leur éventuel départ. Cela les aidera à comprendre qu’ils ne sont pas obligés d’entrer dans les rangs. Au Canada notamment, de nombreuses structures sont prévues pour les primoarrivants. On prépare les lieux où ils sont censés vivre, ce qu’ils sont supposés penser ou manger. L’exilé doit oser l’aventure, s’affranchir des barrières psychologiques. Mais il ne doit pas juger un pays ou un peuple avant de l’avoir effectivement rencontré. Il doit foncer, aller là où on ne l’attend pas, faire semblant de ne pas comprendre quand on insinue qu’il n’est pas à sa place.
Mais la forme littéraire choisie, faite de prose et de vers libres, pourrait rebuter.
Si on se contente de feuilleter l’ouvrage, peut-être. À la lecture, c’est un style assez simple. Et ce mélange de prose et de rimes est aussi une métaphore de la vie : on a souvent besoin de marquer une pause ; on oscille perpétuellement entre accents lyriques et ton plus prosaïque. Ces textes poétiques en prose sont pour moi les plus simples à manipuler. Ils sont débarrassés de tout corset. Dans mon livre, quelque 450 paragraphes racontent des dizaines de petites histoires. Toute la difficulté consiste à procurer de l’émotion au lecteur et à donner du rythme à chaque petite phrase. On voit les choses surgir ; il n’y a pas de distance entre l’écrit et l’action. C’est une écriture délestée de toute fioriture qui cependant n’empêche pas le raffinement.
Mon souhait est que ce livre soit lu par de jeunes Africains avant même leur premier départ pour l’étranger.
Il y a aussi dans cet ouvrage une certaine exaltation de l’insouciance.
Le jeune homme qui fuit une dictature n’a pas besoin de se plaindre en permanence. Il peut s’octroyer une année de vacances consacrée à lire, boire, rencontrer des filles… En exaltant cette insouciance, j’ai aussi voulu souligner qu’elle faisait vraiment défaut dans les pays fortement politisés, comme Haïti dans les années 1970. Cette insouciance transparaît dans chacun de mes ouvrages. À la parution de mes premiers livres, critiques et journalistes se demandaient si je devais être classé parmi les « écrivains légers ». Ils ont fini par me donner du « grand auteur ». J’ai placé les briques les unes après les autres, sans jamais donner l’impression que je voulais ériger une oeuvre. On a fini par comprendre que je ne me contentais pas d’aligner les livres les uns après les autres, mais qu’il y avait, derrière, un projet. Par petites touches, je passe d’un sujet à l’autre, change d’angle de vue, à une vitesse folle. Et cette manière de procéder donne l’impression d’un sautillement, qui au final aboutit à un scintillement. C’est en quelque sorte la métaphore de la jeunesse. Le jeune homme est confronté à un vaste champ d’opportunités, lui qui vient d’un pays en autarcie. On le voit, excité, explorer ces possibilités.
Avec une pointe de cynisme parfois…
En réalité, il est simple, direct et vrai. C’est touchant. Par exemple, il ne prend pas de précautions oratoires pour déclarer, parlant de ses conquêtes : « Julie, c’est pour l’amour, Nathalie, pour le sexe, et il me faut vite quelqu’un pour l’argent. » Ça peut paraître cynique, mais le narrateur est sauvé par sa juvénilité. Il joue tellement franc jeu que c’en est désarmant. C’est un prisonnier en cavale qui ne veut être possédé par aucune femme. Il ne laisse aucun sujet s’emparer de son être, pas plus l’amour que le travail.
Avez-vous consciemment fait de cette première année une période initiatique ?
À mon arrivée à Montréal, la dictature et la colonisation faisaient déjà partie de moi, mais ne m’empêchaient ni de vivre, ni de traverser le monde, ni de regarder les autres. Je ne regarderai jamais un Blanc uniquement comme un colon. C’est réducteur, à la fois pour lui et pour moi. Outre les choses anodines comme la différence de température, j’ai appris la liberté, la solitude, mais aussi l’intimité. Pouvoir m’asseoir à la terrasse d’un café et commander, geste d’une extrême banalité pour n’importe quel Montréalais, correspondait pour moi à la traversée d’un siècle, à une longue conquête. Cela dérangeait à la fois le dictateur et l’opposant, parce qu’ils avaient tous les deux pour moi un projet. Le premier voulait m’assujettir, le second, que je me révolte. Quant à moi, je n’aspire qu’à m’enfoncer dans le quotidien. La chose en apparence la plus frivole est au contraire la plus puissante. La réponse la plus subversive à la dictature, c’est d’être heureux.
Quel est votre rapport à Haïti aujourd’hui ?
La dictature fut éphémère, Haïti est éternelle. Je n’ai jamais eu de rapport crispant à mon île. Je me suis astreint à démontrer que l’exil pouvait devenir un acte libérateur. La pire des choses qu’on puisse faire aux dictateurs, c’est s’accomplir, transformer la punition en récréation. Aujourd’hui, trente-six ans après, je m’emploie toujours à retisser le lien.
L’exilé que vous restez a-t-il gardé cette audace des premières heures ?
L’ensemble de mon oeuvre semble le dire. Je n’hésite pas à traverser l’Amérique pour donner mon opinion, non pas uniquement sur le débat racial ou encore les rapports contrastants entre riches et pauvres, mais aussi sur la littérature, sur Spike Lee comme sur Woody Allen. Il faut éliminer les frontières, en particulier celles qui nous emprisonnent. Les barrières sociales, raciales ou de classe constituent déjà de véritables carcans. Inutile d’en rajouter en nous imposant une ligne d’horizon au-delà de laquelle notre regard n’a plus le droit de se porter. Tous mes livres disent la même chose : il nous appartient de nous organiser dans l’espace, entité qui, par définition, n’appartient à personne. En revanche, cet espace revient à celui qui s’en empare, non pas pour en faire sa propriété mais pour pouvoir circuler, observer, vivre.
___
Propos recueillis à Québec par Clarisse Juompan-Yakam

Chronique de la dérive douce, de Dany Laferrière, Grasset, 224 pages, 16 euros.
Alain Mabanckou contre la malédiction de l’homme noir
Propos recueillis par Bernard Quiriny – Le 04/01/2012

Trente ans après le ‘Sanglot de l’homme blanc’ de Pascal Bruckner, l’écrivain Alain Mabanckou lance un pavé en cette rentrée littéraire de janvier avec ‘Le Sanglot de l’homme noir’, où il renvoie dos à dos les discours victimaires et accusateurs sur la « question noire ». Un point de vue tranché sur la situation des Noirs en France et celle de l’Afrique dans le monde, nourri d’expériences personnelles et de littérature… Rencontre.
Comment avez-vous décidé d’écrire cet essai ?
Après avoir vécu en France (plus de 17 ans) et aux États-Unis depuis le début des années 2000, j’ai observé ce que certains appellent la « communauté » noire. Ce livre est en quelque sorte le fruit de cette observation. J’ai voulu aborder la question en partant de mon expérience et sous forme de brefs récits qui essaient de comprendre le sanglot de l’homme noir et sa posture d’éternelle victime.
Vous évoquez le fameux débat sur l’identité nationale qui a agité la France entre 2007 et 2009. Qu’en avez-vous retenu ?
 J’ai retenu de ce débat que la France traversait une crise profonde, et que les marchands des idéologies rivalisaient de stratagèmes. On ne peut pas donner une définition exacte de l’identité car elle est subjective, mouvante et se crée dans les actes que nous posons. Il est donc aberrant d’imaginer, voire de créer un Ministère de l’identité nationale. De telles initiatives montrent la montée de la démagogie. Ce qui est hélas le cas en France depuis quelques années. Et le Front national n’a désormais plus le monopole de la surenchère.
J’ai retenu de ce débat que la France traversait une crise profonde, et que les marchands des idéologies rivalisaient de stratagèmes. On ne peut pas donner une définition exacte de l’identité car elle est subjective, mouvante et se crée dans les actes que nous posons. Il est donc aberrant d’imaginer, voire de créer un Ministère de l’identité nationale. De telles initiatives montrent la montée de la démagogie. Ce qui est hélas le cas en France depuis quelques années. Et le Front national n’a désormais plus le monopole de la surenchère.
Vous écrivez que « l’assistance n’est que le prolongement subreptice de l’asservissement ». Vous méfiez-vous des politiques d’aide au développement menées depuis les années 1950 par les pays occidentaux ?
L’aide arrive rarement à ceux qui en ont le plus besoin, et c’est par le biais de l’assistance que les anciens colonisateurs tiennent les États africains. En ce sens, nous sommes dans une colonisation déguisée. On même l’impression que c’est l’Occident qui choisit les présidents africains et décide de les décapiter lorsque ceux-ci essayent d’installer une rupture. Dans ces conditions, les indépendances africaines ne sont que des mots vides de sens.
Vous avez des mots très durs contre Éric Zemmour et ses propos récents. Mais ne pensez-vous pas que le refus de la victimisation noire que vous défendez dans votre livre trouverait un écho favorable chez lui ?
Pour critiquer les autres il faut faire son autocritique. Je dirais même, pour parodier un discours connu, que Zemmour pose de bonnes questions mais donne sciemment de mauvaises réponses, pour alimenter un fonds de commerce dont il a seul le secret. Il y a une attitude de victimisation dans le monde noir. C’est un fait indéniable. Mais pour autant je ne peux pas imputer aux Noirs la responsabilité de tous leurs malheurs. Il y a une part « blanche », mais dois-je consacrer mon existence à m’occuper de ce que le Blanc m’a fait ou de ce que je devrais faire ici et maintenant pour préparer mon avenir ? Là est la question.
Dans votre jeunesse, pour un jeune Africain, venir en France était une sorte de rêve, quasiment « un pèlerinage à la Mecque ». Est-ce toujours le cas aujourd’hui ?
La France reste pour beaucoup d’Africains un Paradis. C’est sans doute le cas pour toutes les anciennes puissances coloniales, puisque le rêve du colonisé est de mettre les pieds dans le pays de son maître, espérant ainsi atteindre la civilisation qu’on lui a enseignée dans les manuels d’histoire où il n’y a jamais sa photo. Ce fait est illustré dans la littérature africaine : plusieurs romans mettent en scène l’arrivée du personnage principal en Europe, et ce voyage se termine généralement de façon tragique. L’Europe a su inventer le mythe de la civilisation parfaite et inculquer à ses anciens colonisés la fatalité d’une malédiction qui ne disparaîtrait qu’avec l’adoption de la civilisation occidentale.
Vous notez que les Africains sont très hostiles à la reconnaissance de la responsabilité noire dans l’histoire de la traite, d’où un silence de plomb sur la question. Comment le comprendre ?
 Alain Mabanckou, © Sébastien Dolidon – EveneOn nous a appris à toujours enjoliver l’histoire africaine. C’est ce que le mouvement de la négritude a fait dans les années 1930 jusqu’aux indépendances africaines. Dans l’esprit de beaucoup d’Africains, l’Afrique était un continent paisible, et l’Europe est venue troubler cette quiétude. Mais qu’en est-il de l’esclavage des Noirs organisé par les Noirs ou les Arabes, bien avant l’arrivée du Blanc ? Il n’y a qu’à regarder la condition de l’homme noir dans le monde arabe pour se faire une idée. Dans cette région, le Noir est presque un objet. On ne le voit pas dans la société. Il n’est pas à la télé. Il n’occupe pas de hautes fonctions. Il y a des Noirs algériens, marocains, tunisiens. Et ils sont brimés de nos jours. Personne n’en parle… parce que c’est un tabou. Parce que celui qui oserait en parler serait forcément considéré comme un traître. C’est ce qui est arrivé au grand écrivain malien qui avait abordé le sujet dans son magnifique roman Le devoir de violence, paru au Seuil en 1968…
Alain Mabanckou, © Sébastien Dolidon – EveneOn nous a appris à toujours enjoliver l’histoire africaine. C’est ce que le mouvement de la négritude a fait dans les années 1930 jusqu’aux indépendances africaines. Dans l’esprit de beaucoup d’Africains, l’Afrique était un continent paisible, et l’Europe est venue troubler cette quiétude. Mais qu’en est-il de l’esclavage des Noirs organisé par les Noirs ou les Arabes, bien avant l’arrivée du Blanc ? Il n’y a qu’à regarder la condition de l’homme noir dans le monde arabe pour se faire une idée. Dans cette région, le Noir est presque un objet. On ne le voit pas dans la société. Il n’est pas à la télé. Il n’occupe pas de hautes fonctions. Il y a des Noirs algériens, marocains, tunisiens. Et ils sont brimés de nos jours. Personne n’en parle… parce que c’est un tabou. Parce que celui qui oserait en parler serait forcément considéré comme un traître. C’est ce qui est arrivé au grand écrivain malien qui avait abordé le sujet dans son magnifique roman Le devoir de violence, paru au Seuil en 1968…
Que pensez-vous des théories sur la trahison des écrivains africains qui écrivent dans une autre langue (le français en particulier), et qui s’installent en Europe ?
Certains écrivains veulent se détacher de la langue française – et donc de la France. C’est certes une initiative originale. Mais sur le terrain nous assistons à une situation cocasse : les mêmes écrivains qui demandent la rupture avec la France acceptent les distinctions que celle-ci leur offre. C’est le cas par exemple de l’écrivain camerounais Patrice Nganang, qui est le chef de file des « francophobes » mais qui est venu récemment à Paris pour prendre sa Mention spéciale du Prix des cinq continents de la Francophonie pour un livre écrit en français et publié en France ! Paradoxe, non ? Eh bien, c’est ce que j’appelle « la littérature à l’estomac » : on critique, mais quand on a faim, on picore les miettes jetées par terre par ceux qu’on houspillait.
Dans le livre, un personnage vous critique en disant que vos propos reflètent finalement votre position sociale favorisée (vous êtes universitaire, intellectuel, vous voyagez beaucoup, etc.), qui vous coupe du « peuple Noir ». Qu’en pensez-vous ?
La position que j’occupe n’est pas le résultat d’un quelconque « héritage » de classe sociale. Je ne viens pas d’un milieu social aisé. Mes défunts parents étaient des gens ordinaires – ma mère était illettrée, comme je le souligne dans mon roman Demain j’aurai vingt ans. Mon père était un réceptionniste dans un petit hôtel de Pointe-Noire. En France j’ai vécu à Garges-les-Gonesses, à Sarcelles, à Château-Rouge, dans le 18ème arrondissement et à Montreuil, dans le 93. Ce que j’ai dans ma vie, je l’ai eu par la force de mon travail. Et peut-être aussi parce que je refusais ce que les autres acceptaient : la malédiction de l’homme noir.
Vous suggérez finalement, pour combattre la vision fantasmée et politisée d’une Afrique victime et unie, de parler d’Afriques, au pluriel. Que voulez-vous dire ?
L’Afrique est variée, multiple. Et les Africains doivent apprendre à se connaître. Un Sénégalais, un Antillais, un Guyanais et un Congolais ne se connaissent pas forcément et, pour s’exprimer, ils passent par le français. Mais il se trouve toujours des démagogues pour nous dire qu’il y a une Afrique, une seule, avec une seule culture ! Et on nous parle de la communauté noire en France. Dans mon livre, je souligne que cette communauté n’existe pas. De même que l’Afrique, qui reste à inventer au présent, et non avec les vestiges du passé.
Le sanglot de l’homme noir, d’Alain Mabanckou
Fayard, 180 p., 15 €
D’un silence à l’autre – Fred Edson Lafortune – entretiens avec Arnaud DELCORTE
PREMIÈRE PARTIE
Fred Edson Lafortune : Arnaud Delcorte, ton tout premier livre de poésie intitulé « Le goût de l’azur cru » vient d’être publié par Le chasseur abstrait éditeur, pourquoi ce titre ?
Arnaud Delcorte : Ah, je suis heureux que tu me poses cette question ! Ce titre est issu d’un commentaire de mon amie et poète Catherine Boudet concernant mes écrits (ou un texte en particulier, je ne me souviens plus exactement). J’ai adoré cette formule et lui ai immédiatement demandé si je pouvais l’emprunter pour intituler mon premier recueil. Ça s’imposait comme une évidence. Ce qui fut fait. Le « Goût de l’azur cru », c’est peut-être au premier degré celui de la chair, de la viande crue mais alors ce serait une chair « cosmiquement » investie au point de devenir ciel ou mer ; la chair en quelque sorte sublimée dans un grand mouvement des équinoxes, le rythme des girations célestes. Mordre l’azur et le goûter, c’est goûter l’esprit, si telle chose est possible. Un esprit-substance qui, en dépit d’apparences multiples, fait un avec le corps et le cosmos, comme l’enseigne le Bouddhisme que je pratique. Et, comme Catherine Boudet l’a sans doute perçu, l’azur c’est aussi la couleur du ciel des corps qui me font frémir, de ceux qui sont nés sous des latitudes plus clémentes que celles de France et de Belgique. Une sorte de métaphore qui lie l’homme au monde. Comme tu as pu t’en rendre compte, au centre de mon livre, il y a les hommes. Et l’Homme avec un « grand » H. Le goût de l’azur c’est l’indéfinissable goût de l’homme et du monde comme s’ils ne faisaient qu’un. OK, ça fait un peu pompeux, je l’avoue.
Fred Edson Lafortune : Tu as commencé à écrire à partir de quel moment ?
Arnaud Delcorte : J’ai écrit mes premiers textes vers l’âge de 18-20 ans (c’est-à-dire il y a très longtemps !). Après coup je me dis que c’était peut-être lié à mon homosexualité non-révélée, dans le sens où je me suis senti à ce moment incapable d’exprimer ouvertement les tempêtes qui agitaient mes océans intérieurs. D’où l’écriture, plutôt comme un journal. Tu sais, 18 ans, la fac, c’est l’âge où tes copains s’éclatent, draguent et baisent et moi j’étais un peu paumé à l’époque. Mais pour autant, mes premiers textes ne parlaient pas de ces sujets, donc je ne sais pas ce qui en était réellement la cause. J’ai toujours eu un grand plaisir à manier les mots, l’écrit. C’est une fascination qui ne m’a pas quitté. Ça a quelque chose de rigoureux et riche à la fois. À certains moments, l’écriture a été une thérapie ; à présent, c’est un plaisir. J’ai un peu honte de le dire mais jusque très récemment, je n’ai jamais écrit pour des lecteurs éventuels, juste pour moi. Très égoïstement.
Fred Edson Lafortune : Mais, qu’elle est ta conception de l’écrit, de la poésie plus particulièrement ?
Arnaud Delcorte : J’ai l’esprit ouvert en ce qui concerne la poésie qui est loin de se limiter au langage. Et si on s’en tient aux mots, pour moi, la poésie va jubilatoirement et sans solution de continuité d’Abou Nawas à Eluard ou Césaire, de Rimbaud à des personnalités contemporaines pas nécessairement identifiées en tant que poètes, comme Abd Al Malik, que je cite d’ailleurs dans mon livre « Le goût de l’azur cru » et certains « slameurs » ou rappeurs. J’ai vraiment un problème avec les barrières, que ce soit en art ou en sciences, ou même entre l’art et les sciences ! Pour moi l’écrit et le « dit », le langage, c’est probablement le lien principal entre les hommes et les femmes, la toile qui les relie et les engage dans la vie. Peut-être pas le seul, mais peut-être bien le plus important. Et la poésie, c’est vraiment la Vénus ou l’Apollon au panthéon du langage. Un fruit juteux à croquer à belles dents. Cependant, la poésie ne peut pas se contenter d’être belle, surtout aujourd’hui. Je pense qu’elle doit aussi être transgressive dans la forme et dans le fond, subversive, dénonciatrice, politique… Et nous, poètes, ne pouvons plus nous permettre le luxe d’être seulement des esthètes. Mais, à vrai dire, un tel luxe a t-il jamais existé ? Aujourd’hui, on sent mieux l’urgence, qui nous bouffe littéralement les c…, et il faut prendre parti, se positionner et agir. Être au monde et pas seulement aux mots. Indépendamment de l’écriture poétique ? Je ne crois pas. Nul besoin de faire le grand écart entre la vie et la poésie car elles sont une. Et indissociables. L’objet de la poésie, c’est l’homme (la femme) et le monde. Et pour moi, ça implique, par exemple, questionner les frontières entre les hommes ou les femmes, entre les races et entre les genres. Je cite Mabanckou (dans « Lettre à Jimmy ») : « — Parce que, voyez-vous, moi aussi je suis un homme invisible. Je suis un blanc, mais en réalité je suis un Noir… Et comme je suis un Blanc, on ne me voit pas, on ne voit pas ma misère puisque je suis du côté de la majorité. Et depuis, je vis comme ça, dans l’espoir que Dieu me rende ma vraie peau un jour.
— Je ne comprends pas…
— Vous ne pouvez pas comprendre. Passez me voir demain.
— Où ? »
Où ? Là où « Je croiseLa fureur d’une paire d’yeuxL’accident d’un visageL’oued scarifié d’une lèvreViergeAsséchéePresque dure ».
La poésie francophone actuelle est heureusement multiple et multiculturelle, et elle embrasse les aspects que je viens de citer, mais à mon avis, pas encore assez. Le français devrait être complètement ouvert par rapport au mélange des cultures et des genres. Je tiens d’ailleurs à saluer ici le travail extraordinaire des éditeurs et collaborateurs de la revue « Point-Barre », éditée à Maurice, qui, en matière de mélange, me semblent vraiment aller dans la bonne direction en publiant dans les mêmes pages des textes en créole, anglais, français… avec des auteurs de tous horizons et nationalités. Et il est d’ailleurs étonnant de constater une grande cohérence intellectuelle lorsqu’on feuillète les pages de cette revue. C’est dans ce genre de laboratoire que j’aime travailler. Par ailleurs, j’apprécie vraiment que la langue poétique épouse les nouvelles formes et les nouveaux styles comme le rap ou le slam qui sont eux-mêmes le résultat de métissages complexes où l’oralité et la performance redeviennent premières. Bien que je ne sois pas moi-même un performeur ! Mais attention, le choix de la forme conditionne la langue utilisée et même, dans une certaine mesure, le propos. Rien ne sert de conter fleurette en rap. J’aime reprendre cette maxime de Frank Lloyd Wright qui a dit d’ailleurs que l’architecture (organique) est poésie : « Look with scorn and suspicion upon all efforts to create the beautiful without an underlying sense and knowledge of what constitutes good building, good structure. » L’enjolivement est inutile en poésie, l’important, c’est l’intégrité, la vérité du verbe. Et la force du verbe c’est sa capacité à bouger, à évoluer, à constamment se redéfinir. Et avec un contexte et des médias sans cesse changeants, je suis convaincu que la poésie trouvera toujours de nouvelles formes. C’est une des choses qui m’intéressent le plus. La poésie a toujours été le lieu par excellence pour faire évoluer le langage… Tout comme, prosaïquement, l’industrie spatiale tire le développement technologique ; encore cette idée du laboratoire de recherche. Et paradoxalement, il y a aussi l’immobilité du poème, l’immuabilité du poème écrit, qui me fascine. Comme une sculpture ou, pour refaire écho à Wright, une œuvre architecturale. Une trace laissée au monde. J’aime creuser le poème, au moment d’écrire j’ai toujours l’espoir de faire apparaître l’évidence de la beauté pure, ou plutôt qu’elle se révèle à moi. Il y a bien sûr un aspect mystique dans l’acte de création. En pratique, dans ma poésie, je laisse une grande place à l’accidentel, aux associations automatiques. J’essaie que le crime ne soit pas prémédité. Avec le temps j’ai développé des techniques pour ça.
Pour revenir au propos de mon livre, le but n’était pas vraiment de transgresser des interdits, vu que je vis dans un pays où deux hommes peuvent se marier, et pourtant, il semblerait que le sujet continue à poser problème à beaucoup. C’est amusant de penser qu’il était traité avec peut-être encore plus de liberté et de naturel dans certains cercles du monde musulman, à une époque où en Europe on brûlait les sorcières ! Avec « Le Goût de l’azur cru », j’espère pouvoir faire entrer le lecteur, quelles que soient ses préférences sexuelles, dans l’univers de la –ou des– relations que j’évoque, de l’asseoir pour une heure aux commandes de mon cerveau et de le faire regarder par mes yeux. Je crois que la poésie est un excellent médium pour ce genre d’expérience.
Fred Edson Lafortune : Tu es professeur de physique à l’université à Bruxelles, en quoi la physique a t-elle influencé ton livre ?
Arnaud Delcorte : Difficile question… Je ne crois pas qu’elle influence directement mon livre mais, malgré moi, ce background scientifique a probablement un impact sur la structuration de ma pensée et a fortiori sur ma production littéraire. Sur le fond, ma formation scientifique m’a permis de relativiser le degré de connaissance –et de conscience– accessible à l’homme et, au même titre que le Bouddhisme, de me positionner plus précisément en tant qu’être humain au sein de quelque chose qui le dépasse. Et corollairement, elle m’a fait ressentir encore plus le besoin de faire de la poésie. J’avoue que je considère la poésie comme un outil d’investigation du monde, au même titre que mes recherches scientifiques. Et comme dans toute recherche, je crois que le processus a autant d’importance que le produit final, voire plus. Pour moi, le chercheur et le poète, c’est un peu cette image d’Épinal de l’alchimiste qui cuit, distille, décante, recueille les produits de fermentation et condense les vapeurs, jusqu’à opérer complètement et exactement la transformation recherchée. Mais pour l’écriture, en ce qui me concerne, ce processus d’alchimie est essentiellement inconscient car j’écris la plupart du temps d’un seul jet, sans retravailler mes textes par la suite. Ou peu. Je dois être un peu fainéant… J’espère aussi apprendre quelque chose de ces bâillements incontrôlés de l’esprit. En réalité, lorsque j’ai commencé à écrire et pendant longtemps, mon but premier a été d’essayer de me comprendre. Est-ce que ce que je dis là a le moindre sens ?
Fred Edson Lafortune : « Le goût de l’azur cru », est-ce une tentative ?
Arnaud Delcorte : Une tentative, oui, on peut dire ça. Tentative d’écrire la substance d’une relation, de l’amour, entre deux hommes en circonscrivant plutôt qu’en décrivant. Un portrait en creux car l’amour –entre hommes ou en général– est, à mon avis, proprement indescriptible par une approche directe. Au lieu de ça j’utilise mes poèmes comme des petits coups de brosse pour tenter de définir une silhouette. Silhouette qui malgré mes efforts reste floue ou mal définie, d’ailleurs. Et ce n’est pas plus mal. Un peu comme certaines peintures de Nathan Oliveira que j’adore. Ça me fait d’ailleurs penser à un grand principe de la physique quantique, le principe d’incertitude d’Heisenberg, ce qui me ramène à ta question précédente. Un avatar de ce principe dit qu’il est impossible de déterminer à la fois exactement la position et la vitesse d’une particule (un électron par exemple). Plus on s’approche d’une détermination exacte de la position, plus la vitesse devient incertaine, au point de devenir « infiniment incertaine ». Et vice-versa. De la même manière je crois que tenter de définir précisément les caractéristiques d’une relation, d’un amour, est voué à l’échec (ou à l’ennui !). Tu vois, parfois, la physique microscopique peut rejoindre celle des sentiments… Donc « Le goût de l’azur cru » serait une tentative très naïve de faire sens de quelque chose qui peut-être défie le sens, et les sens… Mais sur le chemin, on apprend quelques petites choses !
DEUXIÈME PARTIE
Arnaud Delcorte : Fred Edson Lafortune, « En Nulle Autre » : c’est le mystère de la femme indissociable de ceux du monde et de la mort ?
Fred Edson Lafortune : En tant que poète, j’ai toujours été hanté par l’érotisme. Par cette grande thématique qui a laissé ses empreintes dans la littérature universelle. Mes lectures de quelques grands chefs-d’œuvre tels « Les Crimes de l’amour » du Marquis de Sade, « Fragments d’un discours amoureux » de Roland Barthes, « l’Amour fou » d’André Breton, « Belle du Seigneur » d’Albert Cohen, pour ne citer que ceux- là, ont beaucoup marqué mes pérégrinations littéraires. En fait, je revendique dans « En Nulle Autre » une esthétique du corps féminin fusionnant avec celles de la musique, la danse, l’espace-temps, la misère, et en quelque sorte l’ésotérisme.
En écrivant « En Nulle Autre », j’ai voulu d’une part rendre hommage au corps féminin, dire de façon particulière ces femmes d’Haïti « tôt se levant pour porter sur leur tête le poids des montagnes, des collines et des rivières ». D’autre part, j’ai voulu m’approprier les mystères tels le symbolisme de l’arbre et celui de la pierre.
On peut remarquer la pertinence du thème symbolique de l’arbre dans la Bible (l’arbre de la connaissance du bien et du mal), dans les mythes antiques et dans les contes africains et haïtiens (le baobab, le mapou, le bagnan…). L’arbre est à la fois considéré comme le symbole de la mort et de la vie. Dans la paysannerie haïtienne, c’est peut-être le cas dans beaucoup d’autres pays, à la naissance, le cordon ombilical du nouveau-né est généralement enterré avec ou sous un arbre (souvent un cocotier) qui procurera à l’enfant l’attachement symbolique à la terre ancestrale.
Dans le vodou haïtien, l’arbre joue un rôle très important. Dans chaque temple du vodou, il y a un potomitan (poteau mitan) qui désigne le rapport et la communion entre le sacré et le profane. Il symbolise le péristyle du « hounfor » autour duquel dansent les « hounsis » (initiés). Ils y posent des offrandes, pendant que des « vévés » sont tracés à même le sol. Le symbolisme de l’arbre apparait très souvent dans « En Nulle Autre ». C’est, à mon avis, une espèce de retour à la terre ancestrale. La terre mère. Celle qui, tel un pilier, supporte les fondements de l’univers.
Le dernier poème de « En Nulle Autre » s’intitule « Rumeur de la pierre ». C’est une thématique que je souhaiterais exploiter au maximum dans mes prochains livres. Elle existe dans la littérature maçonnique, on y retrouve dès le premier grade ce symbolisme de la pierre. Ce symbolisme est présent dans de nombreuses traditions comme la tradition chrétienne (tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église), islamique (le pèlerinage des musulmans à la Mecque où ils font sept tours autour de la Kaaba, la pierre noire qui serait un météorite tombé du ciel), et antique. Dans « En nulle autre », je parle de la pierre pour faire référence au Saint Graal qui serait, tel qu’il est décrit dans Perceval, une pierre dure appelée lapis exillas rappelant la pierre philosophale des alchimistes : « Précieuse est la rumeur de la pierre / Un symbole entre le calice et le sang »
Arnaud Delcorte : C’est très riche cette symbolique de la pierre/œuf philosophal(e), pierre des sages, conjuguant les principes mâle et femelle, et celle de l’arbre/pivot/connexion entre le monde du bas et celui du haut. Ce sont des choses qui résonnent en moi également ; pour preuve cet extrait de mon bouquin qui fait écho au tien : « Pour qu’enfinToute rumeur apaiséeLa nuitScelle de nos sangsLa pierre incendiaireDu scandale ». Il semblerait finalement que nous ayons des préoccupations communes… J’aimerais juste ajouter deux références contemporaines sur la symbolique de la pierre, source –encore– de connaissance et de transformation dans le film de Stanley Kubrick « 2001 A Space Odyssey » et, une image bien belge, issue du surréalisme, le contresens de cette pierre suspendue tel un nuage dans la toile « Les idées claires » de René Magritte : « Le vent charrie tes motsTresse tes chantsDans la toile des joursDes pierres au tableau de nos sens ». Moi, je voulais te demander, Fred, un peu perfidement : Pourquoi, aujourd’hui, en 2009, un jeune homme haïtien de 27 ans choisit la poésie pour s’exprimer devant ses contemporains, pour faire face au monde ? Est-ce que la poésie « traditionnelle » a encore une place dans ce monde mental du XXIe siècle ou est-ce juste une gâterie pour esthètes nostalgiques ?
Fred Edson Lafortune : À mon avis, ta question met en jeu le rôle du poète et celui de la poésie. C’est à dire la fonction et l’essence même du poète et celles de la poésie. Parfois, je me demande ce que c’est qu’un poète, ou d’une façon plus générale, ce que c’est qu’un auteur. Je pense à une conférence de Michel Foucault, « Qu’est-ce qu’un auteur ? », donnée à la Société Française de Philosophie en février 1969. Je pense aussi à un article de Roland Barthes publié en 1968 intitulé « La mort de l’auteur ». Je fais allusion à Barthes et à Foucault pour dire que cette question de la notion de l’auteur est l’une des plus contestées dans les études littéraires. Quand je parle ici de l’auteur, je parle de son caractère intentionnel, c’est-à-dire, le rapport qui existe entre le texte et son auteur. Ou encore la responsabilité que l’on attribue à l’auteur sur le sens et la signification du texte. Sans entrer dans ce conflit sur la notion de l’auteur, car il a déjà fait couler beaucoup d’encre, opposant les partisans de l’explication littéraire et les adeptes de l’interprétation littéraire, je dirais que la puissance de l’écrit me semble être anonyme, impersonnelle. Sans identité aucune.
J’accorde beaucoup d’importances au langage poétique. C’est pourquoi, je dis que la poésie est l’art total par excellence. C’est la seule voie où l’on peut être dans le délire total. Hurler jusqu’à en perdre haleine. Montrer ses dents. Ses griffes et ses tripes. La poésie ne se limite pas au seul poème qui est l’une de ses multiples manifestations. Dans un sens plus général, elle englobe toutes les autres formes d’expressions que ce soit la danse, la musique, le théâtre, le cinéma, la peinture, la sculpture… La poésie est esthétique. Paroles. Elle est aussi questionnements, mais ne se limite pas aux questions. Elle est révélatrice. Elle fait en sorte que nul ne puisse ignorer le pouvoir du verbe. C’est la recherche de cette vérité intime qui fait qu’on rentre en soi-même et cherche le pourquoi de son propre monde. La poésie est a priori solitude. Elle est l’acceptation et l’affirmation de ce que l’on est véritablement. Dévoilement de son moi intérieur. Elle est, comme disait T. S. Eliot, « non l’expression d’une personnalité, mais une évasion de la personnalité ».
Je suis poète pour partager avec le monde mes expériences authentiques de la solitude, de la douleur, de l’amour du verbe et de la chair. Ayant donc la possibilité infinie de choisir, j’ai choisi la poésie comme mode d’expression pour dire autrement le monde et ses magnolias, ses églantines, sa couleur, son odeur, ses sels, ses objets, sa forme, sa joie, ses cataclysmes… Lequel choix définit le sens et l’essence de ma vie. Contrairement à ce que tu penses, je dirais plutôt que ce sont les nouvelles formes et les nouveaux styles tels le rap ou le slam qui ont épousé la langue poétique.
Il m’arrive quelquesfois de chercher ce qui est de la poésie dans la poésie, ou plus généralement, ce qui est de l’art dans l’art. C’est-à-dire ce sans quoi l’art n’est pas ou ne sera pas. Je me souviens avoir fait une telle remarque au Guggenheim à New York dans une exposition de Vassily Kandinsky. En regardant les toiles, je sentais qu’il y avait une sorte de transcendance dans le choix et le mariage des couleurs. Mais ce qui me parle dans ses toiles, ce n’est ni l’objet, c’est-à-dire les matériaux utilisés (châssis, qualité des médiums…), ni même la représentation. Ce qui me parle, c’est cette toute autre chose insaisissable, cette complicité entre la représentation et l’objet qui me renvoie au sublime, qui fait que l’art est exactement. Pour la poésie idem. Le poète travaille sur un matériau qui est le langage. Lequel travail donne corps à une parole poétiquement intime, différente de celle des médias, de la communication, du bavardage, du discours scientifique –ce qui, dans son sens empirique, différencie le langage de la parole poétique. La poésie, c’est cette connivence entre le langage/objet et ce que devient cet objet en touchant notre âme. Ce qui fait qu’elle est sensible. D’une extrême sensibilité.
Arnaud Delcorte : Tu mentionnes le Guggenheim, un bâtiment extraordinaire conçu par Frank Lloyd Wright à la fin de sa vie, une sorte de conque marine qui symbolise pour moi les circonvolutions du cerveau. Bel exemple d’art en architecture, à mon avis. Moi, j’y ai été frappé par « L’Accordéoniste » de Picasso. Un accordéoniste cubiste ou bien un village berbère envahi par les dunes après une tempête de sable. Un accordéoniste clairvoyant portant en lui la nostalgie du Grand Sud. Être capable de provoquer ce genre de révélation qui crée des liens nouveaux comme des synapses entre les mondes et transforme notre façon de penser, de voir au sens rimbaldien, ça pourrait peut-être définir l’art et la poésie… Mais revenons à ton livre… Tu penses qu’il y a un « universel » de l’amour ? En particulier, vois-tu une différence entre l’amour d’un homme pour une femme ou entre deux personnes de même sexe ?
Fred Edson Lafortune : Je ne sais pas ce que tu appelles un universel de l’amour. N’y a-t-il pas de nuance entre universel de l’amour et l’amour universel ? De toute façon, je pense que l’amour, en tant que concept, peut être abordé sous différents aspects tant au niveau biologique, psychologique, sociologique, philosophique, théologique que psychanalytique…
Concernant le second volet de ta question, je ne vois pas sincèrement trop de différence entre l’amour d’un homme pour une femme ou entre deux personnes du même sexe, bien que je ne sois pas homosexuel. J’ai suivi avec assez d’attention le mouvement homo un peu partout à travers le monde. Il faut dire que chez moi, en Haïti, les homos ne s’affichent pas ouvertement vu qu’il y a beaucoup d’hypocrisie dans le milieu, une sorte d’auto censure, une peur de s’affirmer ou de s’accepter soi même comme on est. Il faut dire également que l’Haïtien est très homophobe. Je me souviens qu’une vingtaine d’homos ont manifesté à St Marc (Haïti) le 30 novembre 2008 sous le regard stupéfait de plus d’un. Mais, ce n’était pas essentiellement une manifestation d’homos puisqu’elle avait été organisée à l’occasion de la journée nationale du VIH/SIDA. Ce jour-là, sur vingt homosexuels ayant fait le test de dépistage, 18 avaient été testé positifs. Ils vivaient avec le virus dans le sang.
D’un point de vue moral, l’homosexualité fait l’objet d’idées très controversées. Mais la morale, n’est-ce pas ces espèces de règles qui font la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Des règles qui sont extérieures à nous, à notre nature humaine, c’est à dire construites et imposées par des instituions comme l’église, la société, la culture… Émile Durkeim disait : « Quand notre conscience parle, c’est la société qui parle en nous », dans le sens où la morale est acquise. Moi, je me retrouve plus ou moins dans ce que Kant appel « la conscience morale » qui se trouve à l’intérieur de chaque individu. Elle consiste à revenir sur ses actes, les juger et les examiner. C’est moi qui juge. Par l’intermédiaire de cette conscience. Bien que pour Freud, le « surmoi », c’est à dire cette conscience morale dont parle Kant, cette capacité que nous avons de juger si c’est bien ou si c’est mal, est acquise par l’éducation, la sanction…
Je me réclame donc de la morale kantienne dans le sens qu’elle est a priori. C’est à dire, tirée de la seule raison. Une morale pure, universelle, nécessaire, indépendante de toute expérience. Chacun peut trouver des critères et des principes moraux universels. Partagés par tous. Nous en avons tous dans notre raison.
Une action qui serait en rapport avec ces critères tirés de cette raison pure est dite morale. L’action morale n’est pas jugée de par son but (faire le bien, plaire aux autres…) mais de par sa cause. Ce qui compte, c’est l’intention dans laquelle on agit, en rapport avec les critères moraux universels tirés de notre seule raison.
Du point de vue littéraire, la thématique de l’homosexualité est évoquée par de nombreux auteurs. J’en ai lu plus d’un. J’ai lu « Billy Budd » d’Herman Melville. J’ai lu, entre autres, « Feuilles d’herbe » de Walt Whitman, « Femmes Damnées et Lesbo » de Baudelaire, « Le Testament d’Oscar Wilde » et j’en passe. Sans oublier ton livre « Le goût de l’azur cru » que j’apprécie énormément. J’aime beaucoup la franchise, la fougue (aller à la rencontre des garçons sauvages), la sincérité et toute la poésie qui s’en dégage.
La littérature homosexuelle n’est pas enseignée dans les écoles haïtiennes, je pense que c’est peut-être le cas dans beaucoup d’autres pays où les manuels scolaires ont mis en quarantaine la littérature proprement dite homosexuelle. Cependant, j’ai vu à Paris des éditions et des librairies qui sont destinées essentiellement aux homos. Ce n’est pas seulement à Paris d’ailleurs. Je crois, comme a dit Benoît Pivert, qu’on est sur la voie d’une libération de la parole homosexuelle dans la littérature.
Arnaud Delcorte : Oui, c’est certain, du moins dans le monde occidental. Il faut voir également la floraison d’études sur le sujet qui, dans les librairies américaines, occupent à présent des rayons qui leurs sont dédiés, la place de l’homosexualité dans les « gender studies », le mouvement « queer ». Fred, qu’est ce qui te pousse à te lever le matin pour écrire ?
Fred Edson Lafortune : J’écris pour me réinventer. Je me suis construit un monde dans lequel je vis ma vie de poète et auquel je donne sens. Un monde mien par ma liberté de choisir. Je ne sais pas si c’est moi qui ai choisi l’écriture ou si c’est elle qui m’a choisi. Elle est pour moi une panacée. Un moyen de voyager vers d’autres mondes. Des mondes que j’ai connus mais souvent qui n’existent pas. Chaque poème est le fruit du rapport que j’entretiens avec mon double, avec les choses qui m’entourent. Chaque poème est témoin oculaire de mes vécus, de mes rapports avec le monde qui existe en moi.
Toutefois, s’il y a quelque chose qui me pousse à écrire, je ne le sais pas. Je ne cherche pas non plus à le savoir. L’inspiration, si elle existe, je n’y crois pas trop. Platon disait que les grands poètes épiques écrivaient par inspiration, qu’ils étaient hors d’eux-mêmes en écrivant. On aurait dit une force extérieure qui chevauche le poète et le pousse au délire poétique. Si tel est le cas, la poésie entant qu’acte de création n’a plus son sens.
La puissance de l’écrit vient de l’intérieur. C’est la part la plus intime de notre intimité même. Il n’y a pas de force extérieure au poète le guidant à faire quoi que ce soit. Il y a tout simplement interaction entre le monde qui nous entoure et celui qui est à l’intérieur de nous.
On écrit en utilisant des techniques d’écritures, ce qui permet à l’écrivain d’en avoir une qui lui est propre. Toute écriture est pour moi solitude. C’est une action personnelle avec laquelle on ne peut pas tricher. On ne peut pas mentir en écriture. Mais il y en a qui le font, malheureusement.
Arnaud Delcorte : Et demain, sur quelles pistes artistiques t’engageras-tu ?
Fred Edson Lafortune : Des expériences dans le théâtre. J’en ai déjà fait beaucoup comme comédien. J’ai travaillé aussi avec des élèves à Port-au-Prince, en mettant en voix et en espace quelques uns de leurs textes. J’aimerais bien faire une carrière dans la peinture. Pourquoi pas…
PS: ce texte a été publié pour la première fois par la revue RAL,M en France en mai 2010
Entretien avec Denise Bernhardt
Fred Edson Lafortune: Denise Bernhardt, vous êtes membre de la Société des Gens de Lettres de France, sociétaire de la Société des Poètes et Artistes de France, membre de l’Association littéraire franco-haïtienne Passerelles. Vous avez publié plusieurs recueils poétiques, dont le plus connu, l’Ame Nue, a été traduit en créole. Vous avez obtenu le prix Aragon de la Société des Poètes Français en 2000 pour Dialogue Ensoleillé écrit avec René Eyrier, le prix de la Fondation Yolaine et Stephen Blanchard en 2002 pour Lacrime, le prix Publio Virgilio Marone à Rome en 2003 pour l’Ame Nue, le prix littéraire Pensieri in versi décerné par l’Académie Internationale Il Convivio en Italie en 2006 pour La Vie en Marelle écrit avec Charitable Duckens dit Duccha, poète haïtien.
Que voulez-vous ajouter à cette brève présentation?
Denise Bernhardt: Tout d’abord je tiens à préciser que c’est vous-même qui avez traduit « l’Ame nue » en Créole avec gentillesse, avec talent, et que je vous en sais grée, infiniment. C’est toujours un honneur pour un auteur de voir son oeuvre prendre vie dans une autre langue, dans un autre pays, d’autant plus si, dans le dit pays, il a tissé avec le temps de multiples liens d’amitié.
En ce qui concerne la présentation elle-même, elle n’est pas exhaustive, ne serait -ce qu’en raison du Grand Prix des Erotides 2007 que je viens de recevoir, décerné par le Cercle Européen de Poésie Francophone POESIAS.
Par ailleurs je suis sociétaire de la Société des Poètes Français, la plus ancienne association poétique et la plus honorifique, fondée en 1902 par José Maria de Heredia, Sully Prud’homme et Léon Dierx.
Mes poèmes dans leur ensemble ont été publiés dans de nombreuses revues, en France et à l’Etranger, ainsi que dans quelques Anthologies, j’ai participé à des émissions de Radio Régionales, et certains textes ont inspiré un peintre, Daniel Olivier, dans le cadre d’une exposition à thèmes. Enfin comme beaucoup d’auteurs, je m’éparpille sur quelques pages d’Internet à l’initiative de sites amis.
Vous êtes née en France, à Cannes. Quel est le plus beau souvenir que vous gardez de votre enfance?
Qu’elle heureuse idée que celle d’évoquer son plus beau souvenir d’enfance ! L’enfance en elle-même devrait toujours être un seul beau souvenir. Malheureusement c’est loin d’être invariablement le cas. Mon enfance a été partagée entre Cannes et Annecy, où sont ancrées mes racines paternelles. Cette alternance qui commença alors que je n’étais qu’un bébé, était due au fait que mes parents travaillaient tous les deux : ma mère dans l’hôtellerie, et mon père comme pâtissier. Durant les saisons touristiques de la Côte d’Azur, où les journées de travail comptaient double, il leur était impossible de s’occuper d’une enfant, et c’est ma grand-mère Mélanie qui héritait de la lourde responsabilité d’élever une petite fille turbulente, ayant acquis très vite la réputation «d’être un ange en classe et un diable à la maison. » J’étais fille unique selon l’expression, un peu trop peut-être !
Mon enfance à Cannes fut couleur mimosa, de ceux que je revois illuminant la cour de l’école maternelle, elle fut le parfum acidulé des oranges , difficilement épluchées à l’heure du goûter par nos mains enfantines, elle fut eaux vives, poissons dansant que nous tentions d’attraper, dans leur nage tranquille au fil des bassins dormant au fond du square, où les mères conduisaient leurs progéniturs l’après-midi.
Cannes était une succession d’instants heureux, baignés de bleu, à l’ombre des palmiers, dans la floraison violettes des glycines croulant sur les murs des jardins, et l’éclat vermillon des géraniums. Mais aucun souvenir particulier ne me vient à l’esprit. Si ce n’est les jeux de ballons propulsés à grands coups de pieds par les garçons du quartier où je m’enrôlai souvent, car les rues à cette époque ne représentaient pas un grand danger pour les enfants.
A défaut je livrerai quand même un joli souvenir de Cannes.
Tous les ans avait lieu « La Fête du Mimosa ». Chaque Comité de quartier élaborait un char, entièrement couvert de mimosas. Je faisais partie de l’escouade de jeunes et de filles, qui devait animer la fête, défilant tout l’après-midi sur les chars, dans les rues de Cannes et en bord de mer, en lançant sans discontinuer des brins de mimosas et des tonnes de confetti sur la foule. La sexualité débridée n’était pas encore de mise et nous avions de longues jupes de satin vert pomme, avec des corsages bouton d’or, nous ne dansions pas non plus, c’était plutôt un bouquet de sourires et de frais minois que l’on offrait aux Cannois ravis, dans l’enthousiasme des chansons et des musiques du moment. Ce fut une journée magnifique où je croyais être une princesse, saluant ses sujets, sous les vivats et les applaudissements !!!!
La femme n’était pas encore devenue un simple objet sexuel. Les hommes conservaient une certaine pudeur tout au moins apparente. Ils appréciaient que le corps féminin soit suggéré plutôt qu’offert, et savaient que le plaisir de la découverte était le prélude indispensable à la jouissance.
Quelles étaient les distractions à Cannes?
Pour moi elles sont synonymes du célèbre film « LA BOUM » avec Sophie Marceau. Nous sortions en bandes, et la méditerranée était notre complice : les heures d’insouciance joyeuse passées sur les plages de la Croisette, les sorties dominicales aux Iles de Lérins, au large de Cannes. Et là, les filles se voyaient responsables des paniers de pique-nique, pour ces graines d’homme qui ne songeaient qu’à la drague, car la moyenne d’âge devait se situer aux environs de 15 ans. Les îles nous enivraient de leurs senteurs aphrodisiaques, nous brûlaient de soleil, et du plaisir cuisant des premières caresses à l’ombre des pins parasols.
Caresses, je dis bien car au-delà était un « no man’s land, » sans la contraception qui n’existait pas encore, ni les préservatifs qui n’étaient pas dans nos moeurs. Le dernier bateau « des îles » ramenait toute cette jeunesse « débraillée », épuisée, à la peau dorée par le soleil déclinant, sur la terre ferme, jusqu’au Dimanche suivant.
En dehors des plaisirs de la plage, une vespa arrêtée sous une fenêtre, pour récupérer une fille, puis une autre, donnait le signal des virées en ville et du rassemblement devant le bar « des Allées » situé non loin de la mer, et du Kiosque à Musique. Le seul souci était de trouver une villa ou un appartement, désertés momentanément par les parents, susceptibles d’accueillir nos boums, aux musiques langoureuses des Platters, des Beattles, et de Paul Anka qui nous faisait fondre avec sa chanson : « You are my destiny ». Les premiers Rock de Johnny Holliday rythmèrent nos premières joutes amoureuses autant qu’innocentes. Les filles exhibaient leurs robes neuves, juponnées et tourbillonnantes tandis que les garçons faisaient leurs premières armes.
Autrement nous allions sagement au Ciné Club du Palais des Festivals, pour voir des chefs d’oeuvre comme « La Strada » de Federico Fellini avec l’inoubliable Juglietta Massina, ou « Le Voleur de Bicyclette » de Vittorio de Sica. Certains après-midi nous voyaient préférer les Jeunesses Musicales de France qui rassemblaient les amateurs de musique classique.
Je n’ai jamais assisté à une conférence, contrairement aux jeunes haïtiens, par contre je lisais beaucoup grâce à la bibliothèque de mon quartier, et à celle de ma meilleure amie, dont la maman, professeur de Français, venait de mourir prématurément.
Enfant, vous aviez un goût certain pour la peinture, pourquoi?
Certainement parce que l’un de mes ancêtres d’Annecy était peintre, au début du 19ème siècle, spécialisé dans les reproductions de scènes champêtres, et de cours de ferme, les poulaillers étaient très à la mode en ce temps là. Les gênes avaient du se transmettre jusqu’à moi. Depuis toute petite chez ma grand-mère, je peignais à la gouache des rectangles de papiers à dessin, et cela assez bien pour qu’à l’âge de 16 ans mes parents m’offrent pour mon anniversaire une magnifique boite de peinture à l’huile. En même temps je rencontrai celui qui devait devenir mon mari, et le premier chef -d’oeuvre que je réalisai, un violoniste, fut pour lui.
Quel a été votre parcours en peinture?
Ce fut un amusement d’adolescente sans plus, à 18 ans je parti travailler à 700 Km de chez moi comme institutrice, mais tout le long de ma vie le goût du dessin, fusains, pastels, et sanguines ne m’a jamais quitté. Et certains furent assez bien réussis. Plus tard, Jean Marais habitait Vallauris, de passage chez son encadreur tomba en arrêt devant un chat que j’avais réalisé en pastel satiné, et l’emporta quelques jours chez lui, avant de le ramener à sa propriétaire. (J’en avais fait cadeau à une amie) Bien plus tard je me souvins de l’anecdote et j’envoyais au combien célèbre acteur mon premier recueil : « Où La Lumière se Pose, » ce qui me valu une belle lettre autographe, que je garde précieusement. Il estimait les poètes étant l’ami intime de Jean Cocteau, le Prince des Poètes comme chacun le sait. Mais j’aimais vraiment la peinture, si je n’ai pas continué c’est par manque de place, et surtout à cause de cette vie de famille qui m’a envahie à l’âge où d’autres sont encore étudiantes. Visiter une galerie est resté un grand plaisir pour moi, ainsi qu’assister à des vernissages.
A cette époque, avez-vous eu des indices de votre choix d’écrire?
Non, on ne choisi pas d’écrire, c’est l’écriture qui nous choisi.
Et elle m’a choisie à l’âge de 9 ans où je composai mes premiers poèmes, initiée par une institutrice d’une classe fondamentale comme vous dites en Haïti.
Quels étaient les écrivains que vous lisiez à l’époque?
Mes livres préférés étaient « Les Nourritures Terrestres » d’André Gide, Rimbaud et Verlaine ainsi que leurs biographies, « La vie de Francesco Goya », « La Peste » d’Albert Camus, « Plongées sans câbles » car la beauté du monde sous-marin me fascinait, et les vers de Rimbaud m’emportaient dans un abîme de rêveries : « Et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer… » qui pourra égaler un jour « Le Bateau Ivre »
Je lisais tous les « Nelson » de ma grand-mère : Hugo (Les Misérables, Notre-Dame de Paris) Alphonse Daudet, Lamartine, Alexandre Dumas, des gens très recommandables en somme.
J’oubliais les bandes dessinées, Tarzan, Spirou, Le Journal de Mickey. Et par ailleurs « Tropiques du Cancer », livre érotico, porno, et philosophique, que je trouvai caché au fond de l’armoire de mes parents. Enfin je l’ai parcouru, il était tellement gros avec ses mille pages, je l’ai vite abandonné!
A vingt ans, vous vous êtes déjà mariée, comment avez-vous organisé votre nouvelle vie?
Dire que j’ai organisé ma vie serait vraiment prétentieux, il suffisait de me regarder pour que je sois enceinte, disaient des voisins bien intentionnés, et 5 ans après mon mariage, mes quatre filles étaient nées. Parler de nouvelle Vie, c’est un peu abusif aussi, j’étais passé de l’adolescence, à l’état de mère de famille sans transition, hormis une année d’enseignement.
Comme on dit familièrement, j’étais débordée et je faisais seule, l’essentiel des tâches, donnant souvent à manger à deux petites en même temps, assises devant moi dans leurs « baby relax ». Ouvrant la bouche devant la cuillère comme des oisillons dans un nid. Un peu plus tard à 30 ans je portait de longues tresses, et les commerçants me prenaient pour une des filles de la maison, demandant à mon mari l’autorisation de me donner un article à crédit. Des visiteurs aussi sur le seuil de la porte me demandaient de bien vouloir aller chercher mon « papa ».
Et maintenant, vivez-vous toute seule ou en famille?
Entre cet heureux temps que je viens de décrire, car c’est celui de la jeunesse et aujourd’hui, le fleuve de la vie a coulé.
Je vis avec mon mari, (le même !) à Montmorency, et presque en famille, car ma fille aînée habite un ‘immeuble voisin du nôtre. Deux de mes autres filles vivent aussi dans des immeubles jumeaux à 10 km, et la troisième est à Paris à 20 km. Elles sont mariées et nous avons cinq petites filles. Cette famille est une tribu de filles. L’un de mes gendres a été déclaré forfait, pour infidélité notoire, il me reste donc trois gendres. Il se peut d’ailleurs que le « forfaitaire » en cours de remariage soit prochainement remplacé. C’est en bonne voie.
Depuis quand êtes-vous arrivée à Montmorency?
Nous sommes arrivés à Montmorency, ville que j’avais choisie en baladant mon pendule sur une carte, en 1982, Ce fut un déchirement car j’adorais Strasbourg la capitale alsacienne, où nous venions de passer 15 ans. Cet appartement dans la résidence où nous sommes toujours, me semblait un grand studio, les plafonds à 2,50m au lieu de 3,20m précédemment m’étouffaient, comme les chambres rétrécies de moitié.
Complètement claustrophobe je passai une partie de mes nuits sur le balcon durant la première semaine.
Concernant Montmorency, rien ne m’intéressait, et même aujourd’hui je ne connais que la place du marché !!! ainsi que le trajet pour aller à Enghien, petite ville déjà plus vivante. J’ai fini par comprendre que mon HLM de luxe comme disait un ami, beaucoup de gens auraient été heureux d’y vivre en France et de part le monde.
Etes-vous croyante?
Oui, à l’intérieur d’une belle église, je sens une présence, un apaisement, je suis dans un refuge, un abri. J’allume un cierge au pied de la Vierge ou d’un Saint. J’aime être entourée des oeuvres d’art que les siècles ont fait naître, et mon plaisir le plus intense, est d’entendre, dans la solitude majestueuse d’une cathédrale, l’organiste répéter pour un prochain office. Cependant je n’ai pas la Foi. Je ne crois pas qu’un être supérieur régisse nos vies. La phrase de Voltaire : « Je ne puis croire que cette horloge n’ait point d’horloger » je ne la partage pas. Pour moi la religion est « l’opium du peuple », soeur du pouvoir. Cela permet de dire au peuple qui a faim : « Priez, Dieu y pourvoira, » ou « le mal, il existe en punition de vos péchés ». Le seul diction qui me parait sensé est le fameux : « Aide-toi, le ciel t’aidera ». C’est-à-dire qu’il faut d’abord puiser dans son énergie et sa volonté, pour surmonter les difficultés. Et c’est vrai que lorsque nous avons fait cet effort souvent la situation s’améliore, et tout se met à bouger dans la bonne direction. Un peu comme un lourd traîneau qui, une fois décollé de la neige se met à glisser doucement, puis de plus en plus vite sur les chemins glacés. Les peuples sont comme ces lourds traîneaux, ils ont besoin d’une force supplémentaire pour se mettre en mouvement et aller de l’avant.
Après votre baccalauréat, vous avez eu un court passage dans l’Education Nationale.
Que retenez-vous de cette expérience?
Ma brève carrière d’enseignante ne fut pas vraiment un choix. Mes parents après mon bac de philosophie, ne pouvaient plus continuer à subventionner mes études. Je vois encore mon père, blanc de colère en s’apercevant que mes livres en fin d’année étaient comme neufs ! le pauvre, il les avait payés cher.
Je n’ai jamais appris un cours de philo, je me contentai d’écouter très attentivement le professeur. Le bac je l’avais passé en Juin, et dès Septembre, je partais avec la grande malle de mes parents pour un poste de remplaçante au centre de la France, dans l’Indre, pays d’étangs au charme étrange et nostalgique, tout frissonnants au moindre souffle de vent, pays de cultures et de vergers, parsemé de fermes, aux longs murs gris, avec en leur centre d’énormes tas de fumier, ennoblis par la lumière du soir.
Région du Berry marquée à jamais par La Dame de Nohant : Georges Sand. De cette année je garde le souvenir de la visite du château de Nohant où elle écrivait en compagnie de Chopin, Musset et d’autres artistes devenus immortels.
Pourtant j’aimais enseigner, j’aimais les enfants, et ils me rendaient cette affection, certains ont pleuré quand je suis partie.
Rebelle à toute autorité je ne respectais pas l’Inspecteur d’Académie, je déchirai sous son nez une dissertation. Je finis pas démissionner, ne supportant pas l’éloignement. De plus en cours d’année scolaire je « me retrouvais » enceinte, mon futur mari, revenant de la guerre d’Algérie, était venu m’embrasser après avoir revu sa famille, et m’ayant regardée, il m’avait fait un enfant !
Je crois que j’aurais été à ma place en tant qu’institutrice ou professeur de français, le destin n’était pas de cet avis.
En ce qui concerne l’expérience en elle-même, ce fut une année où je vivais dans des villages de 200 à 300 habitants, logée dans des maisons sans chauffage, avec -20°C en hiver, dépourvues de tout : une table, un banc de bois, un lit , une cheminée, pas de toilettes, rien.
L’instituteur m’appris à faire du feu, la nuit je mettais sur mon lit le contenu de la malle pour ne pas geler, et je me nourrissais de bouillie de farine de blé, que l’on donne aux bébés, de pain, de jambon, de beurre et de lait agrémenté de café ou de chocolat.
La classe réunissait tous les âges de 6 ans à 13 ans. J’avais trois groupes. Quand les uns écrivaient, je faisais lire les autres et dessiner la troisième section. L’heure d’après on inversait le tout ! Un folklore que connaissent bien les maîtres encore aujourd’hui dans la France profonde.
En hiver les plus grands allumaient un vieux poêle qui fumait de toute part. Le rituel était bien établi : je faisais sortir tout le monde, car l’air était irrespirable, on ouvrait tout grand les fenêtres, et nous attendions frissonnant dans la cour gelée, que la combustion s’équilibre, et que cet engin infernal veuille bien cesser de fumer.
Au bout d’un moment nous pouvions rentrer et les leçons commençaient.
Les relations humaines, qui avaient débutées par la poignée de main du maire et un mot de bienvenue, s’étaient poursuivies par une amitié avec le couple d’instituteurs s’occupant de l’autre classe et un jeune couple du village. Même pas un élément masculin désoeuvré qui aurait pu égayer ma vie monotone.
Je m’ennuyais, je rangeais la classe, et je me souviens encore du mot d’adieu et de remerciement de l’institutrice en poste :
« au moins vous avez bien rangé mon placard !!! »
En effet j’avais trouvé en arrivant un capharnaüm absolu.
Je partis sans regret de ce poste, avec des réflexions assez désabusées sur le métier d’enseignante.
Ce que j’ai vécu, je l’ai vu, retracé au détail près dans un film à la télévision : Remplaçante en 1961, dans un village de France.
Beaucoup abandonnaient où devenaient dépressives avant la fin de l’année scolaire. Je fis partie des démissionnaires.
Deuxième partie
Fred Edson Lafortune: A partir de quel moment avez-vous commencé à écrire?
Denise Bernhardt: C’est à l’âge de 9 ans que j’écrivis mon premier poème.
Plusieurs quatrains où il était question du printemps, de chants d’oiseaux. C’est mon institutrice, qui avait voulu nous donner les premières notions de poésie, et je pris le goût d’écrire. Poèmes enfantins, mais dont certains furent déjà publiés dans « Le Républicain Savoyard » d’Annecy.
Quand vous écrivez pour la première fois vos poèmes, avez-vous eu l’intention de devenir un grand écrivain?
Etant très jeune il m’était difficile d’avoir cette idée, je ne savais même pas qu’il existait un métier d’écrivain. Aujourd’hui j’ai simplement le désir d’être lue, toujours davantage, ce qui est déjà très ambitieux. Il est vrai que certains enfants posent l’affirmation : « plus tard je serai …» Et le plus étonnant c’est que certains d’entre eux lui font prendre vie.
Comment écrivez vous?
J’aime bien cette question, car chaque poète a sa manière, sa méthode, sa technique très personnelle. Pour ma part il faut que je ressente une émotion, qui peut être provoquée par un sentiment, un désir, mais aussi par un mot, une métaphore tombée du ciel dans le champ de la conscience. Il faut un évènement intérieur. Souvent je commence le poème dans mon esprit. Une fois sur le papier, j’essaie de le soumettre.
La plupart du temps il fait nuit, je ferme les yeux, à moitié endormie, je suis couchée, l’inspiration est là, je compose dans ma tête, et pour ne pas oublier, je rallume la lampe, j’écris sur une tablette posée sur mes genoux.
J’éteins à nouveau car le sommeil m’envahie, et bien non les mots sont là, c’est comme un rêve qui se poursuit, mais qui veut naître et je rallume à nouveau jusqu’à épuisement.
Comme le dit Wooly Saint Louis Jean, compositeur et interprète Haïtien : « je fais l’amour avec les mots ».
Le matin je reprend le texte, je lis à haute voix, et je le modifie, deux ou trois fois, en le recopiant entièrement, après cela c’est terminé. Si le résultat ne me persuade pas, j’abandonne sans trop de regret.
J’écris vite, je ne traîne pas un texte, je poétise « à la grâce de Dieu ».
Presque toujours je vis un amour en écrivant, je le vis avec intensité.
Je crée pour ma Muse, ce qui est une démarche plutôt masculine d’ailleurs.
Ai-je bien répondu ?
J’oubliais il y a les poèmes de la nuit, mais parfois ceux de l’aube et je trouve qu’ils ont une grâce particulière.
Quand nous écrivons, une présence invisible, guide notre plume, c’est pourquoi nous nous surprenons à nous demander de temps à autre d’où vient tel mot, telle image. Elle vient de notre inconscient, mais aussi de l’inconscient collectif, elle vient de l’héritage des maîtres, de ceux qui vivent encore en nous, autour de nous, dans la bulle irisée où seuls les poètes et les artistes ont accès. Il nous arrive d’avoir le très net sentiment quand nous écrivons, d’être « visités ». Et je remercie alors, à voix haute, le poème une fois terminé, cet ange mystérieux de m’avoir inspirée.
La peinture, n’a-t-elle pas influencé vos oeuvres?
Sans doute et comme le dit mon ami Michel Bénard, nous mettons dans les poèmes ce que nous ne pouvons peindre, et nous peignons ce que nous ne pouvons écrire. Je le paraphrase simplement. Mais je ne mène pas comme lui deux activités artistiques de front.
Un poème est un peu comme un paysage, il lui faut une harmonie, de la couleur, un relief, un rythme, et mille choses indéfinissables, qui en feront une création unique, impossible à reproduire. D’autre part il possède au-delà de la peinture sa propre musique, celle de l’âme.
Avez-vous choisi votre propre lectorat?
Non, je ne fabrique pas des mots, dans l’intention de les « placer » ou de les orienter vers telle ou telle catégorie de lecteurs. Je ne m’en soucie absolument pas. « Qui m’aime me lise ! » seul l’avenir lointain dira si j’ai un lectorat où si j’ai rejoint les arcanes de l’oubli.
Vous n’avez jamais été tenté d’écrire dans une langue étrangère?
Je suis née et j’ai grandi dans des régions de France : la Haute-Savoie, et la Provence, (proche du Comté de Nice) qui furent sous domination italienne jusqu’en 1860. Date de leur rattachement à la France. Je suis très attirée par l’Italie, dont je trouve le patrimoine artistique inégalé en Europe. C’est une terre que je n’ai jamais foulée, mais qui me semble soeur de la France et je pratique l’Italien, à l’occasion. En effet j’ai eu l’idée d’écrire quelques poèmes en Italien, sans pour cela la réaliser. Je me contente d’avoir le plaisir de lire régulièrement mes poèmes traduits en Italien par Angelo Manitta, président de l’Académie Internationale il Convivio dans sa revue littéraire, ce dont je le remercie.
Quels sont les auteurs qui vous ont influencés?
Influencée je ne sais pas, mais les poètes français, qui font parti de notre histoire, nous ont légué leur héritage à travers les époques. Depuis les troubadours, dans la langue la plus pure :
Celle de la poésie orale, aussi ancienne que l’humanité, jusqu’à Victor Hugo et son foisonnement génial, en passant par Ronsard, nous pillons tour à tour, les plus grands auteurs.
Malheureusement dans cet ordre d’idée, certains similis poètes en sont encore à faire rimer, rose avec éclose, et voiles avec étoiles ou toiles.
Verlaine et Rimbaud sont restés mes maîtres, et Jules Supervielle m’a influencé dans sa recherche, du monde réel à travers l’apparence, dans sa façon de briser tour à tour les miroirs pour atteindre l’essence de l’objet ou de l’être. Supervielle qui mena une vie simple, ne cessa de créer, une oeuvre parmi les plus belles les plus vraies, J’en suis très loin, mais j’aime m’apparenter en toute modestie à ce poète.
D’une manière plus directe j’ai été très marquée par un poète comme Michel Bénard que j’ai connu en 1998. J’avais commandé son dernier livre : « Calligraphie » et j’eu le coup de foudre pour son écriture. Son amour de la beauté, la facilité qu’il possède de replacer à tout instant l’inspiration dans le cycle de l’univers, dans l’harmonie originelle, la distance qu’il a naturellement par rapport à la matérialité des choses, tout était séduction pour moi, ainsi que sa façon d’idéaliser la femme, de lui rendre son statut de Muse qu’elle n’aurait jamais du perdre.
Par rapport à sa manière d’évoquer l’amour, avec une sensualité et un art consommés, d’effleurer la vie, d’ignorer tout ce qui la dégrade, la dévalorise, la dénature, je me trouvais en harmonie,avec ce poète, si ce n’est en « osmose » l’un de ses mots favoris.
Je pris ma plus belle plume pour exprimer les sentiments que j’ai tenté de décrire, et je lui en fit part.
Ce fut le début d’une amitié toujours vivante, qui ne s’est jamais démentie. Il me conseilla, avec tact, préfaça deux de mes recueils dont la toute récente « Mangrove du Désir ».
De mon coté je lui dédiais d’innombrables poèmes. Grâce à Michel, j’abandonnai tout à fait la poésie néo-classique et me plongeai avec délices dans les eaux lumineuses de la poésie libérée des contraintes de la forme, à la façon d’un nageur s’immergeant nu dans les vagues
Ma rencontre avec René Eyrier est antérieure, à la précédente.
Nous écrivîmes ensemble : « Dialogue Ensoleillé » Il adorait Aragon et le revendiquait, pourtant ses vers bâtis comme des alexandrins ne rimaient pas, ou au petit bonheur, cependant il respectait la forme en égrainant des quatrains. Pour être en harmonie je faisais de même, en alignant les rimes et les douze pieds habituels. Il m’influença, car notre thème était la Foi ou son Absence, il me donna le goût d’une poésie discursive, il me fit découvrir la richesse et le plaisir d’une écriture à deux voix, que je renouvelais six ans plus tard avec Duccha par le biais d’internet.
Originaire du midi, il avait en même temps une couleur d’ouvrier parisien tributaire du métro, vivant en banlieue avec sa femme, au sommet d’un immeuble de béton. Il avait gardé son accent de Provence, et parfois chantait pour moi dans cette langue, alors que nous cheminions en ville, et nous ne savions même plus où nous allions étant aussi rêveurs et étourdis l’un que l’autre; Le recueil avec René fut le dernier que je produisis en style néo-classique.
Vous avez commencé à publier très tard, est-ce un choix?
Ce sont les circonstances de la vie, je n’avais jamais tellement songé à publier, mais en 1996 je travaillais comme bibliothécaire à mi-temps dans un lycée. En dehors des heures de pointe où les élèves arrivaient tous en même temps, j’avais de longs moments de liberté. Je commençai à taper une centaine de poèmes ayant survécu au temps, et une amie insista pour que je les envoie chez un éditeur.
Je ne sais comment j’eu l’idée des Editions Saint Germain des Prés, (le nom sans doute) mais la réponse fut favorable. Le premier éditeur, sis dans le prestigieux Quartier Latin, fut le bon. Ainsi naquit :
« Où la lumière se pose »
Pourquoi avoir publié de la poésie et non pas les autres genres?
Tout simplement parce que je n’ai aucune aptitude pour le roman comme pour la nouvelle, que cela représente un travail considérable et je suis le contraire d’une travailleuse. J’aime les choses rapides. Toutefois j’écris des articles ou des préfaces pour les recueils que j’apprécie particulièrement, ce qui me permet de faire plaisir dans le même élan.
Vous trouvez le métier d’écrivain difficile.
Oui, surtout quand un ami comme Fred Edson Lafortune me demande de répondre à des dizaines de questions !!!
Le métier d’écrivain me parait surtout qualifier le romancier, mais c’est peut-être un préjugé de ma part.
Le poète gagne très peu d’argent, est-ce un métier? Mais c’est difficile, il donne plus qu’il ne reçoit.
Je citerai Alphonse Daudet et vous laisse méditer :
« Il y a par le monde de pauvres gens qui sont condamnés à vivre de leur cerveau, et payent en bel or fin, avec leur moelle et leur substance , les moindres choses de la vie. C’est pour eux une douleur de chaque jour : et puis, quand ils sont las de souffrir…… »
(La légende de l’homme à la cervelle d’or)
De nos jours aucun poète n’a encore l’illusion de pouvoir vivre de sa plume.
Mis à part vos activités littéraires, n’y a-t-il pas d’autres activités dans lesquelles vous vous impliquez?
Non c’est ma seule et unique passion.
Enfin il m’arrive de dessiner, ou de broder, il doit s’agir d’une anomalie du cycle lunaire, ou d’une période de vacances.
Vous semblez avoir un amour très profond pour le discours poétique.
Oui.
En France, comment accueille t’on vos ouvrages?
Cet une question d’envergure. La France compte 55 millions d’habitants, et la Poésie est lue surtout par les poètes eux-mêmes. Il vaudrait mieux dire comment sont accueilli mes recueils par mon entourage et mes amis poètes, et mes autres lecteurs inconnus.
J’ai reçu de nombreuses lettres d’amis et d’inconnus me disant leur plaisir et leur admiration par rapport aux textes.
Je crois que cette relation avec les lecteurs n’est pas si fréquente. Par ailleurs les succès remportés lors de concours, me font dire que l’accueil fait à mes écrits est satisfaisant.
Comment se répartit votre lectorat dans un pays où des milliers d’ouvrages paraissent chaque année?
Je crois que je viens de répondre à cette question. Il faudrait préciser aussi que le lectorat dépend de la diffusion des livres. La diffusion étant une affaire purement commerciale. Elle demande des moyens financiers importants. Un tirage fait à 500 exemplaires est honorable déjà en poésie.
Actuellement, la publication poétique n’étant pas rentable, l’évolution se fait vers des éditions où la vente s’effectue uniquement par Internet, et à la demande ce qui évite tout gaspillage. Cela n’empêche pas l’éditeur quand il est sérieux, de faire le « Service de Presse » traditionnel et de les présenter dans les Salons du Livre, Expositions, comme cela a toujours eu lieu. Un stock prévu à cet effet est tiré lors de la sortie du livre sur internet. J’insiste, il s’agit alors d’un véritable travail d’édition. Que les poètes débutants se méfient des sites d’édition, vide de tout contenu. Et de tout suivi.
Comment situez-vous vos oeuvres dans la littérature universelle?
Ce sont des poèmes d’amour comme les autres. En art nul ne sait qui va survivre, qui sera connu encore dans 50 ou 100 ans. Cela dépend de nombreux facteurs, parfois insaisissables.
Chaque artiste a le secret désir d’être pérennisé, de se prolonger, une façon de nier notre nature mortelle.
Mon souhait c’est qu’elles soient l’occasion d’une lecture agréable, selon l’expression consacrée, pour le reste je ne serai plus là, pour en juger.
Troisième partie
Fred Edson Lafortune: La poésie, est-elle le produit, à votre avis, de l’inspiration et/ou d’un travail techniquement élaboré?
Denise Bernhardt: La poésie est sans nul doute le produit de l’inspiration.
Elle est un don du ciel, on naît poète, comme on naît musicien ou peintre. Ne dit-on pas : « il ou elle est douée pour … »
Aucun travail ne peut remplacer cette grâce mystérieuse qui nous est donnée, de voir, de ressentir, de transcrire.
J’ai parcouru un livre ancien, doré aux fers, du 19ème siècle, car je suis amoureuse des livres anciens. J’aime leur patine, leur odeur, le velouté des peaux….donc ce petit livre raffiné contenait des sonnets, parfaits sans doute du point de vue de la forme, mais qui ne recélaient pas une once de poésie.
Si le don est la base de tout, il ne constitue pas tout, durant notre vie on ne cesse de l’améliorer, il s’épanouit comme une fleur vivante. Et c’est à ce stade et en ce sens seulement qu’intervient la technique. On apprend comment un poème doit s’articuler, sa cadence, sa musique, on se rend compte qu’il faut souvent épurer, tailler, sculpter les mots, c’est à cet instant que les arts se rejoignent selon les correspondances chères à Baudelaire. On compose un poème, comme un chant, une sculpture, un tableau. C’est simplement une question d’outils :
Un stylo, une plume, un pinceau des couleurs, un ciseau, un burin. L’argument est toujours, pour l’artiste d’être à la fois émetteur et récepteur, mais avec entre les deux, le filtre de sa personnalité, de son intelligence, de sa sensibilité, qui est à chaque fois unique, ne pouvant être recrée, si elle est souvent copiée. C’est le caractère intrinsèque de l’oeuvre d’art.
Un poème se travaille, certes, mais cette étape doit à peine se deviner, comme la beauté en clair obscur, effleurée par les ailes de l’ange.
Quelles relations le poète doit-il, selon vous, entretenir avec l’expression poétique?
Puisque c’est avec lui-même les meilleures possibles.
Pourriez-vous définir ce qu’est votre conception de la poésie?
La poésie doit être accessible, sans qu’il soit besoin d’études supérieures pour la comprendre. Rien de pire qu’un poème où l’on avance à l’aide d’un dictionnaire.
Elle doit trouver une résonance, dans chaque lecteur. Je crois que c’est en cela qu’un poète possède une chance de rester dans la mémoire collective. Il faut avouer que la forme classique, la rime, aident beaucoup à retenir un texte. Rime qui est reprise de nos jours par certaines formes poétiques qui respirent à la limite de la chanson.
En lisant un poème il faut éprouver du plaisir en termes de découvertes : une métaphore nouvelle, une inspiration inédite, une recherche dans l’expression qui cependant doit rester naturelle. Il faut ressentir une qualité d’âme, une personnalité
à travers l’écriture, pour en retirer un enrichissement intellectuel . La poésie permet d’approcher l’idéal, que ce soit la Beauté, la Vérité, l’Amour.
Définir un « beau » poème, n’est pas chose aisée, car la beauté n’a rien à voir avec la naïveté d’une image, elle réside peut-être, dans la justesse du ressenti, et l’art avec lequel il est traduit en simples mots.
Tant que le coeur d’un poète sera ému par une larme tremblant au bord d’un cil, la poésie restera la plus haute expression humaine , permettant de relier une âme à une autre âme par le seul intermédiaire du signe.
Le poète Paul Eluard refuse une poésie qui prendrait ses distances à l’égard du réel. Selon lui, le poète fera une oeuvre authentique en s’appropriant la réalité et en la dominant. Etes-vous d’accord?
Si la poésie prend trop de distance avec le réel elle devient un délire sans grand intérêt, un peu comme ces tableaux abstraits qui avoisinent le néant de la pensée comme de l’expression.
Ce n’est qu’en s’appropriant la réalité pour la restituer à travers le prisme de ses émotions de sa sensibilité, et de son talent , que le poète réalise une oeuvre; Rien ne peut exister en dehors de la réalité sensorielle . C’est pourquoi de nombreuses expériences visant à dissocier le poème du réel, et du sens, se sont autodétruites d’elles mêmes.
Votre vécu quotidien, a-t-il influencé vos écrits?
C’est ici que le petit jeu de la vérité, s’intensifie.
Il m’a influencé de deux manières contradictoires : d’une part en voulant fuir le quotidien, où je n’avais pas matière à retranscrire
« L’écume des jours » selon Boris Vian, et d’autre part en créant une autre réalité à travers l’espace et le temps, qui parfois devient plus sensible que la première. J’ai toujours eu envie de remettre en question le sens du mot platonique, car les idées prennent vie et réalité dans l’imaginaire et le poème. Peu à peu elles font partie de ma vie, et je ne peux les cantonner en des brumes insaisissables. Je connais des émotions platoniques qui génèrent autant de bien ou de mal que des émotions dues à des faits tangibles.
Il est des récits en prose qui présentent des ressemblances formelles avec la poésie telles certaines pages de Chateaubriand ou de Gracq, par exemple, qui sont qualifiées de « prose poétique » parce que le travail du texte, par sa nature, est similaire à celui de la poésie.
A votre avis, faut-il remettre en question le statut même de la poésie comme genre littéraire, quand on observe que certains textes relevant d’autres genres littéraires sont parfois dits « poétiques »?
Vous venez d’exprimer toute la nuance, qui existe entre la poésie, et la prose poétique. Ces textes magnifiques sont « poétiques » mais qui est poétique, n’est pas un poème en soit. Ils s’inscrivent dans un roman dans un récit, qui sont le véritable propos de l’auteur, maintenant s’il possède le talent et le désir de le baigner de poésie, c’est pour notre grand plaisir, mais le poème possède en lui-même sa raison d’être, il n’est pas inclus dans une autre forme d’écrit.
Il a le caractère éphémère de l’instant surtout pour les auteurs contemporains car les anciens égrainaient volontiers de longues stances interminables. Il constitue un tout, une histoire bien souvent, concentrée en quelques mots, ce qui aurait demandé plusieurs pages a un texte en prose. Le poème se décline avec un rythme, une musique, que ne possède pas la prose poétique aussi élaborée soit elle.
Prenez une plume, et vous sentirez très nettement si votre texte est « prose poétique » ou « poème ». Notre disposition intérieure n’est pas la même non plus, dans un cas ou dans l’autre.
Pour ma part je ne peux confondre les deux. Donc le fait de remettre en cause le statut de la Poésie qui se définit étymologiquement comme une « création » est très loin de mon esprit.
On appelle parfois un texte poétique une « poésie », n’est ce pas selon vous, un emploi impropre dans le sens que le texte poétique est un « poème »?
Il est fréquent d’employer un terme à la place de l’autre.
Habituellement on parle de la Poésie comme d’un genre littéraire,
Et le Poème en est la traduction. Je crois que cela est du à une dérive linguistique qui affaiblit le sens en général;
La poésie, n’est- elle pas un monde différent de celui que nous avons l’habitude de voir?
Nous avons le redoutable don de déchiffrer les signes, nous sommes des passeurs, des éveilleurs. C’est nous qui révélons un monde différent, la bulle irisée où seuls les poètes et les artistes ont accès. Nous créons et nous entrons en même temps dans l’univers invisible, dans une autre dimension. Un peu comme être projeté tout à coup dans le Triangle des Bermudes.
Loin de ma pensée l’aspect cyclonique. Si selon Arthur Rimbaud le poète se doit d’être « voyant » il doit garder sa raison. Car la folie n’est pas soeur des arts. Si un certain délire est positif, il faut en garder la maîtrise, ce qu’a compris FRANKETIENNE, et malheur au jeune poète qui prétend l’imiter, il sera en deçà ou au-delà, de toute manière il se perdra.
Comme dans les films de Jean Cocteau qui nous a transmis dans ses oeuvres la symbolique et la magie ancestrale, le poète revêt le gant de velours noir qui lui permet de franchir le miroir, non pas pour aller dans le monde des morts, mais pour atteindre l’illumination apparentée au mysticisme religieux.
Dans quelle circonstance écrivez-vous?
Lorsque je me trouve effleurée « par les ailes de l’ange » !
La poésie, selon vous, peut-elle être faite par tous?
Non, puisqu’il faut à la base un Don. Le poète ne possède pas grand-chose, laissons lui au moins ce privilège.
Qui est poète, à votre avis?
Au risque de me contredire je dirais que tout le monde porte en soi la divine poésie.
La nature humaine est uniforme, penser autrement serait de l’élitisme. Malgré tout, pour obtenir la couleur violette il faut mélanger du rose et du bleu en quantité suffisante, et en proportions égales. Pour beaucoup la poésie restera à l’état embryonnaire et ne verra jamais le jour car l’osmose n’aura pu avoir lieu.
Est-ce que, à votre avis, l’on peut être poète sans jamais publier?
Certainement, même sans jamais écrire. La poésie, est une disposition de l’âme, un pouvoir que nous possédons. Elle appartient au domaine spirituel, et ne passe pas obligatoirement dans le monde matériel qui n’est fait que de contraintes.
Est- ce que vous pensez que la poésie peut apporter quelque chose au social?
Elle est une force, un engagement, même si l’on ne fait pas partie des poètes dits « engagés. » Le poète qui est poreux comme une éponge est à des degrés divers un témoin de son temps. Vous en avez de beaux exemples en Haïti. Parmi les jeunes poètes, le premier recueil de James Noël : Poèmes à Double Tranchant, retentit comme un nouveau « J’ACCUSE! » dans la société insulaire.
Les plus grands poètes, les plus grands écrivains ont été liés à la vie politique de leurs pays, souvent même condamnés à l’exil pour la force de leurs témoignages et les changements qu’elle pouvait amener dans la société. Un auteur s’il le peut n’est pas destiné à s’enfermer dans sa tour d’ivoire, il lui faut accepter de prendre des risques, sans pour cela signer pour le martyr.
Malheureusement, il arrive que le martyr, soit son destin, qu’il ne revendiquait pas. Je n’oublierai pas l’enlèvement puis la torture et l’assassina le 14 Juillet 2005, du poète et journaliste haïtien Jacques Roche, et voici quelques jours de François Latour. Avec vous tous je demande JUSTICE.
Quel est, selon vous, le rôle de l’écrivain?
Je crois avoir répondu.
Quatrième partie
Fred Edson Lafortune: Depuis quand êtes-vous membre de la Société des Poètes Français?
Denise Bernhardt: Depuis le 2 Avril 1998 exactement, parrainée par François Fournet alors président de l’Ouvre Boite, et Jeannine Dion Guérin qui deviendra Secrétaire générale de la Société des Poètes Français.
Gagnez-vous beaucoup d’argent avec vos publications?
L’argent que j’ai gagné, équilibre seulement les dépenses que j’ai pu engager. Il est très important de savoir qu’un poète gagne très peu d’argent. Avec un éditeur, il ne dépensera rien, mais l’usage veut qu’il perçoive 10% sur le prix de vente net du livre. A compte d’auteur, s’il vend bien et par ses soins, dans le meilleur des cas, il sera remboursé de ses dépenses. Un éditeur peut donner également 10% mais en livres – pour un tirage de 1000 vous aurez 100 livres, la rémunération sera close quelles que soient les ventes. Il peut aussi s’agir d’une vente par souscription. J’ai expérimenté plusieurs de ces systèmes. La poésie est donc une activité sans but lucratif, sauf de rares exceptions ou dérives, je pense aux poèmes de circonstances que l’on peut vendre (naissance, mariage, anniversaire) ce que je laisse aux versificateurs.
Situez-vous vos textes dans un courant littéraire?
Je les situe dans la lignée de la poésie amoureuse, mais je ne sais s’il existe un courant littéraire en ce sens. Cette poésie est universelle et intemporelle.
Votre recueil poétique, l’Ame Nue est traduit en Créole.
Comment avez-vous vécu cette traduction?
Je l’ai ressenti comme un grand honneur, et je vous remercie de tout coeur d’avoir mené à bien ce travail. En outre c’est la première fois qu’un de mes recueils est traduit dans une langue étrangère, intégralement.
Jusqu’à présent les traductions ne concernaient que certains poèmes. J’ai eu aussi le sentiment que ce cadeau magnifique tissait des liens indestructibles avec mon traducteur, comme avec Haïti. Votre enthousiasme juvénile pour le texte m’amusait et il m’amuse encore, mais c’est un bonheur total.
Parlez-vous créole?
Non pas du tout, mais je sais dire « Je t’aime » le mot qui ouvre tous les chemins sur la terre. J’ai essayé d’apprendre mais avec mon jeune professeur, on riait tellement, que je ne comprenais plus rien. Par moment je déchiffre au hasard d’un texte, où d’un courrier, quelque mot échappé mais c’est tout. Enfin si je n’ai rien appris où presque, c’est entièrement la faute de mes amis Haïtiens qui ne parlent que français avec moi.
Qu’attendez-vous de cette traduction?
J’aimerai que l’Ame Nue soit publiée (ce serait pour la troisième fois ) en version bilingue, français et créole. Ce sera une joie profonde pour mon traducteur ici présent, et moi-même. J’espère aussi que cette joie sera partagée par tout le lectorat qui a sucé la musique créole avec le lait maternel.
Avez-vous des livres ou des poèmes traduits dans d’autres langues étrangères?
Oui plusieurs de mes poèmes ont été traduits en Italien, et les derniers dans la belle anthologie de presque 700 pages :
« Cento Poeti Per L’Europa Del Terzo Millennio » (Cent Poètes pour l’Europe du Troisième Millénaire) publiée en Italie ,en Janvier 2007 par l’Académie Il CONVIVIO.
Quelle a été l’influence de vos souvenirs d’enfance dans votre écriture, dans l’Ame Nue plus particulièrement?
Je retrouve dans l’Ame Nue un poème qui s’intitule : « l’Enfance Perdue » mais j’ai voulu dire l’innocence perdue, la naïveté, le moment de la vie où l’on croit en tout.
Dans un autre poème : « Outremer », j’évoque une maison sortie tout droit de mes rêves. Ce n’est pas un souvenir d’enfance. Tous mes paysages sont imaginaires sauf si j’évoque un lac, serti de montagnes, où les nuages s’inversent dans l’azur des flots. « Lambeaux »
Dans l’Ame nue, parfois vous invoquez l’espace géographique de la France. Quel sens donner à la représentation que vous faites de cet espace?
Au début de « l’Ame nue » j’évoque l’Abbaye de Royaumont, sous la neige, alors que je ne l’ai jamais vue en hiver. J’ai mis ce poème comme j’aurais mis une belle image, dans un livre d’enfance. Je cite Paris, lieu de toutes les retrouvailles, l’espace géographique n’est que le décor théâtral des poèmes.
Vous parlez, dans l’Ame Nue, de vos amours. Vous en avez connu beaucoup?
Je suis mariée depuis l’âge de 19 ans, et j’ai connu mon mari à 16 ans. Cette année là j’étais dans une institution religieuse pour préparer le bac. C’est donc un amour à travers le temps…..
Mais « nobody is perfect ». Mon mari prudent ne me présentait à aucun de ses amis dans le cadre de ses invitations professionnelles, ce qui lui laissait toute liberté d’ailleurs !
Dans notre vie privée, nous étions une « bande » d’une vingtaine de personnes, on sortait on dansait, et mon esprit commença un jour à vagabonder, ce que je n’ai jamais cessé de faire depuis. Alors l’intention vaut l’action dira le bon curé du village. Par ailleurs le joker s’impose.
Vous parlez toujours d’amour dans vos oeuvres, quelle est la thématique qui vous préoccupe maintenant?
Toujours la même, quoi de plus important sur terre. Le seul bien dont tout le monde peut jouir ! gratuit et non imposable ! pour l’instant ! Plus sérieusement, l’alpha et l’oméga de toutes choses.
Vous avez écrit La vie en marelle avec charitable Duckens (Duccha). Qui d’entre vous a fait choix du titre?
Tous les deux, il était question de « marelle », mais il me semble que j’ai eu le dernier mot pour le titre final.
Comment avez-vous rencontré Duccha?
J’ai rencontré mon petit Duccha sur un site d’internet :
Le Club des Poètes de Jean-Pierre Rosnay. C’est Duccha qui m’a envoyé un mail que je n’oublierai jamais :
« Je suis un poète haïtien, écris moi ». C’était un ordre, pas question de s’y soustraire.
La vie en marelle, qu’est ce que ça pourrait vouloir dire?
C’est une expression très riche de sens, on pourrait écrire un livre entier sur le symbolisme de la marelle, qui est la représentation de la vie, depuis la plus haute antiquité, ce qui a été fait sans doute.
Elle représente donc l’effort, toujours répété, que doit faire l’être humain, pour se dégager de l’élément TERRE, dans l’espoir d’atteindre le PARADIS, c’est-à-dire la libération de la matière. Et ce pavé qu’il faut pousser sans cesse, sur un pied, (ce qui indique notre incapacité d’y consacrer la totalité de notre énergie mentale) représente toutes les difficultés que nous rencontrons au fil des jours. Nous avons pensé Duccha et moi, à nos vies, nos vies imparfaites que nous unissions par l’échange de nos poèmes, dans un geste d’alliance à travers la distance, malgré toutes nos différences.
Comment situez-vous la poésie de Duccha par rapport à la vôtre?
Duccha est un poète lyrique, son inspiration féconde fait que les mots viennent sous sa plume avec facilité. Il a une vision, étendue des choses, il appréhende la vie avec beaucoup de sensibilité, sa souffrance est permanente. J’admire énormément ce qu’il a écrit âgé de 22 ans à peine : Tentatives, et Travers de Clavier Multiples. Un don superbe.
De mon coté, je suis trop enfermée en moi-même, je refuse le monde qui m’entoure, je l’ignore. Ma seule recherche est la quête d’amour. Duccha est le témoin d’une vie, d’un pays, d’un désespoir qu’il ne peut surmonter. De plus il ne croit pas au miracle, aux sectes, il analyse la condition humaine telle qu’elle lui apparaît dans toute sa cruauté. Il a ce courage du « Dire ».
Dans La vie en marelle, vous entretenez, tous les deux, un dialogue poétique très sentimental qui a beaucoup marqué les lecteurs. Existe-il vraiment une relation sentimentale entre vous deux?
C’est évident, nous nous sommes écrit tous les jours pendant plusieurs mois. Nous étions tout l’un pour l’autre à cette époque et « la Vie en Marelle » fut la sublimation de ce que nous avons éprouvé. Vous avez raison d’employer le présent dans votre question, car seuls les amours charnels meurent de leurs belles morts. Les autres qui sont des vibrations lumineuses entre les âmes, ne meurent jamais. Le sentiment qui existe entre nous est de cette nature.
Qu’est ce qui vous a motivé à écrire un recueil poétique à double claviers?
Les poèmes reflétaient nos sentiments, et nous les échangions presque jours après jours. Ils constituaient un véritable dialogue, car Duccha s’exprimait sans entrave, et après quelques hésitations je fis de même. J’avais déjà écrit un recueil de cette manière avec René Eyrier : « Dialogue Ensoleillé » dont le thème était LA FOI, ce fut un grand plaisir, que j’eu tout de suite envie de revivre avec Duccha et il fut d’accord sans problèmes.
Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans la production de ce recueil?
Je n’en vois pas, où j’ai oublié, la difficulté était pour Duccha de trouver un ordinateur de libre, dans son Ecole supérieure d’Economie Appliquée, et du temps pour taper. Il ne m’a pas dit ce qu’il avait enduré avec moi! René Eyrié, longtemps après m’a révélé que je m’étais comportée en tyran, qui l’avait énervé pour les questions d’orthographe, et que je lui avais imposé des décisions. C’est vrai il avait 7 ans de plus que moi, il n’avait pas l’habitude de céder à une femme, d’autant plus que c’était un macho de Provence , du pays de Frédéric Mistral. J’espère qu’il n’en est pas de même pour Duccha. Pour moi ce fut une période très heureuse que la réalisation de ce recueil.
Vous avez réalisé un CD avec les textes de ”La vie en marelle” et vous ne dites que les vôtres.
Pour la bonne raison que Duccha m’avait dit qu’il allait enregistrer lui-même ses poèmes, pour avoir un souvenir de nos voix. J’attends pour le moment. Il devait les intercaler. Je pense qu’un jour un « vrai CD » sera fait par des comédiens avec de la musique. C’est un projet, je crois savoir avec qui le réaliser.
La vie en marelle est publié en novembre 2006 chez Rivarticollection à New York. Comment avez-vous rencontré cette maison d’édition?
C’est Kerline Devise, une amie haïtienne qui effectue un Doctorat à Paris, qui m’a fait connaître la directrice de Rivarticollection. Nous avons eu la chance d’être retenus pour être publiés, par le comité de lecture, et ce fut une chose très positive en soi. Je remercie donc Kerline, de son aide efficace. J’avais rédigé un article pour son recueil érotique : « Mes Corps » qui fut publié dans le Nouvelliste, et repris dans la revue d’Il Convivio en italien en 2006.
Avez-vous déjà été refusée par une maison d’édition?
Par quatre ou cinq en France, en général on vous répond « qu’ils ne publient plus de poésie » ou que malgré la qualité de votre texte, le planning est complet.
Il est très difficile de trouver un éditeur ici, ils reçoivent des milliers de manuscrits par an , pour en publier une vingtaine seulement. Je n’avais pas beaucoup cherché , j’ai été publié gratuitement en remportant des Prix d’Edition, deux fois, et par ailleurs j’utilisais le compte d’auteur.
Vous avez des liens très étroits avec des poètes, artistes et journalistes haïtiens. A quel moment les avez-vous rencontrés?
Très courtoisement, les uns m’ont présenté les autres, sur la demande de ces derniers. Duccha m’a fait connaître ses amis, dont Pierre Moïse Célestin, Samuel Eymieux, Coutechêve Aupont, seul James Noël étant de passage aussi au Club des Poètes m’a proposé directement de correspondre, . Il y a sans doute eu un mouvement de curiosité autour de moi.
Je fis aussi la connaissance des journalistes Juste Jonel et Pierre Jobnel dont j’apprécie beaucoup la gentillesse et l’amabilité en dehors de leur professionnalisme. De plus, c’est un honneur d’être accueillie grâce à eux dans les pages du Nouvelliste, le plus ancien quotidien d’Haïti. Par ailleurs Maggy de Coster me fit rencontrer Dominique Batraville son ami d’enfance, et James noël fit croiser ma route avec celle de Wooly Saint Louis Jean, venu donner un concert à Paris, en 2005.
Quelle est la plus belle et la plus mauvaise expérience vécue avec les poètes haïtiens?
Je rejette le mot d’expérience, car il implique un sujet et un objet, un certain calcul qui n’est pas dans mon caractère. Mon plus beau souvenir ce fut ma rencontre avec Duccha, et cet échange poétique d’où naquit « La vie en Marelle ». Tout fut surprise et découverte, provocation, car les années qui nous séparent, me rappelaient à chaque instant que je vivais des sentiments tout à fait déraisonnables. La sincérité de Duccha, la pureté de ses émotions avaient des clartés de source qui m’éblouissaient.
Mes autres rencontres furent aussi de petits miracles, simplement elles venaient après, et avec la patience d’une araignée je tissais chaque fois une nouvelle toile d’amitié et de poésie, pour ceux qui ont bien voulu me faire la grâce de s’y laisser prendre. Les mauvais souvenirs, il vaut mieux ne pas en parler : « Oublie-le, oublie tout ça » comme il m’a été dit.
Visiter Haïti n’est donc pas important?
Il semblerait plutôt que c’est Haïti qui ne cesse de me visiter, avec sa foule bruyante et bigarrée, son soleil incandescent, ses maisons basses où les voix des femmes gazouillent où jacassent comme des d’oiseaux, et ses palmes berçant des plages inespérées. Si un jour je venais rejoindre cette autre part de moi-même qui se trouve dans votre pays, depuis que Duccha a composé des mots magiques sur son clavier, ce serait pour y dormir à jamais, dans la terre de vos ancêtres, (s’ils veulent bien de moi!) que ce soit à Anse à veau, à Hinches, à Port-au-Prince ou à Jacmel, dans votre terre où les morts ne dorment pas. Ce serait pour rejouer « Mort à Venise » à Port-au-Prince…
Faites-vous des expériences avec d’autres poètes étrangers?
Non je ne fais pas d’expériences avec d’autres poètes étrangers, ce qui serait péjoratif. Je suis les routes d’eau qui, le plus souvent me ramènent à vos rivages.
Avez-vous de très bons rapports avec des poètes et artistes haïtiens vivant en France?
La difficulté des transports quand on habite le Val d’Oise (banlieue nord) fait que j’ai négligé de faire la connaissance d’artistes haïtiens vivant à Paris. J’ai simplement deux amies poètes, Kerline Devise, et Maggy de Coster, haïtienne devenue française par son mariage. Elle est directrice de la revue « Le Manoir des Poètes, » dans laquelle elle a publié certains de mes amis et elle fait partie du Comité de la Société des Poètes Français, parmi bien d’autres responsabilités.
Votre dernière publication « La Mangrove du désir » est une compilation de quatre recueils réunis en un seul. Comment s’est imposé à vous un tel choix?
Un écrivain parisien, Robert Vitton, m’a fait connaître en début d’année « LE CHASSEUR ABSTRAIT EDITEUR » dont la revue présentée tous les 15 de chaque mois sur Internet est LA RALM. Cet éditeur du sud de la France a publié en ligne dans un premier temps : « Les Braises Noires »
Ensuite il a informé les lecteurs de la RALM qu’il cherchait pour sa collection DJINNS des manuscrits de 200 pages. Le projet de la Mangrove était ancien car j’avais quelques inédits, comportant une unité dans l’inspiration. J’ai donc proposé, Concertino et le Coeur à l’Endroit, L’Âme nue, (en 2eme édition) et les Braises noires que je voulais voir publier de façon traditionnelle.
Avez-vous encore des rêves à réaliser?
Je crois que je suis entrain d’en réaliser plusieurs depuis cette année, que vous pouvez deviner en filigranes, dont certains grâce à vous.
Un dernier mot.
« ECRIRE EST UN ACTE D’AMOUR.
S’il ne l’est pas
Il n’est qu’ ECRITURE »
Jean Cocteau
FIN DES ENTRETIENS
24 JUIN 2007
Propos recueillis par FRED EDSON LAFORTUNE
PS: Ce texte a été publié pour la première fois dans le quotidien haïtien “Le Nouvelliste” le 24 septembre 2007.